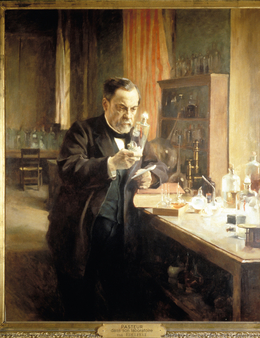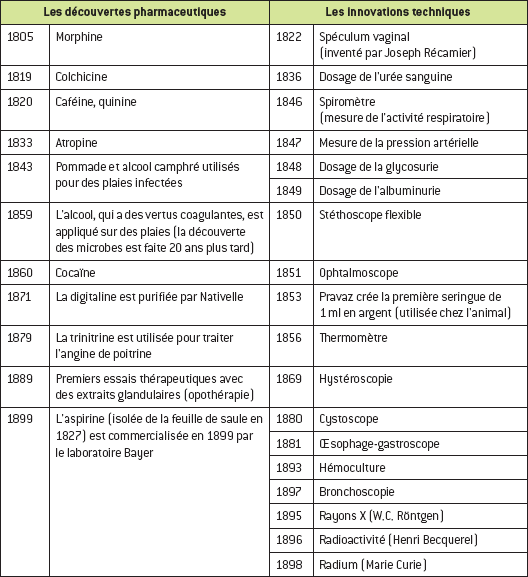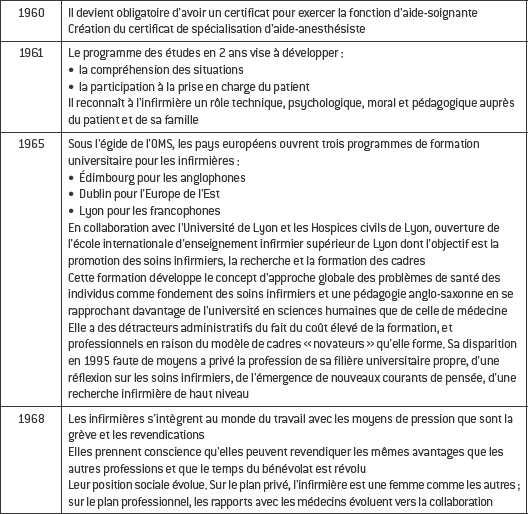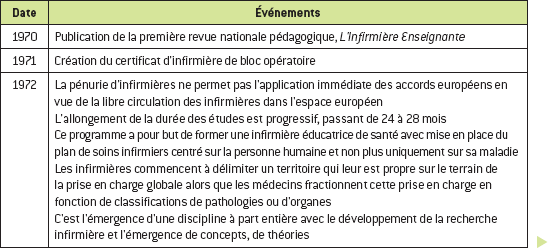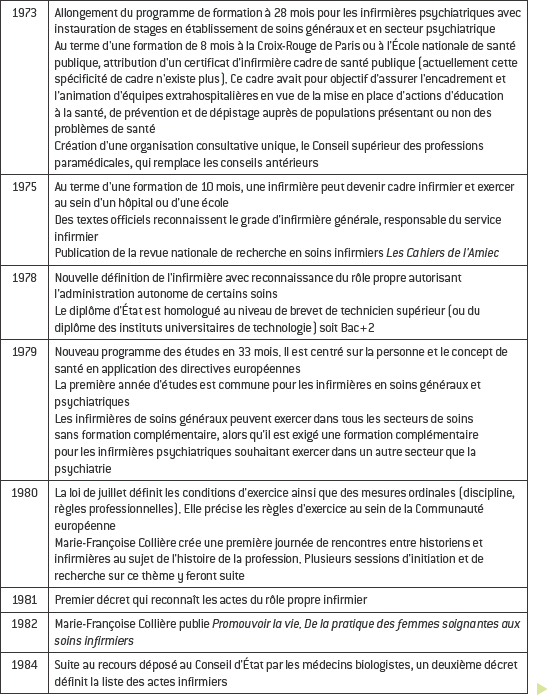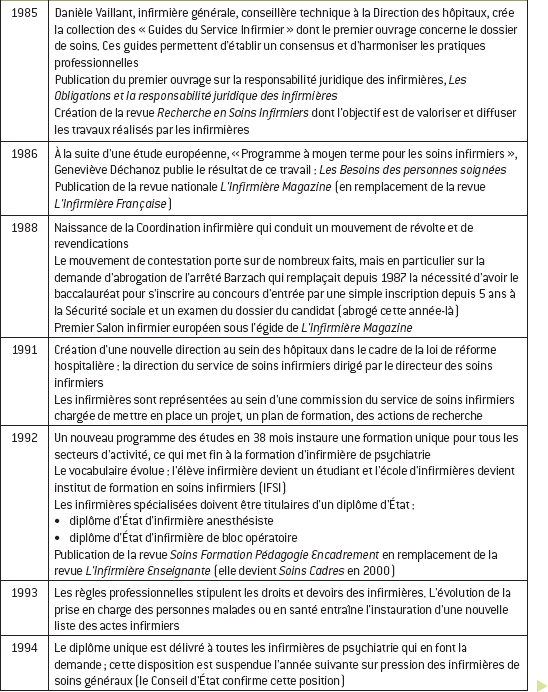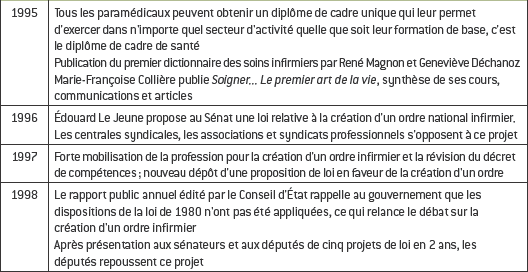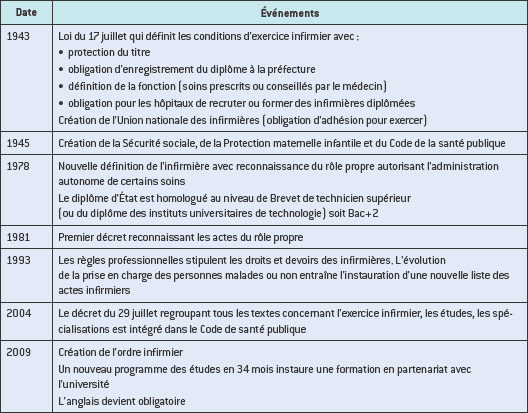Histoire des pratiques soignantes et de la médecine
COMPRENDRE
HISTOIRE DES PRATIQUES SOIGNANTES
L’anthropologie des pratiques soignantes vise à replacer le développement de l’homme dans son contexte de vie, dans son histoire et son environnement pour souligner à la fois sa grande fragilité et sa capacité d’adaptation pour survivre dans des conditions difficiles. Au cours de l’histoire, l’homme a démontré son aptitude à s’organiser et à vivre en société, à développer des savoirs et des savoir-faire qui l’ont aidé à s’adapter et à vivre en ayant une « maîtrise » toujours plus grande de son environnement.
Aborder l’histoire des pratiques soignantes et de la médecine nécessite un passage obligé, celui de la réflexion quant à l’acception ou plutôt aux acceptions du terme « soigner ».
« Soigner, prendre soin de la vie est à l’origine de toutes les cultures. Depuis le début de l’histoire de l’humanité, les hommes et les femmes se sont efforcés de trouver comment survivre1. » Ainsi, les pratiques de soins se sont développées autour de ce qui permet d’assurer la vie.
Soigner, c’est donc assurer la continuité de la vie du groupe et de l’espèce, c’est prendre soin de la vie pour qu’elle puisse demeurer.
 Fondements culturels
Fondements culturels
La principale priorité de l’homme est de se nourrir, de trouver la nourriture et de la préparer, ce qui a donné naissance aux différentes pratiques alimentaires des civilisations. Mais se sustenter requiert un ensemble d’activités prises en charge par des hommes ou des femmes, selon leur particularité. Cette organisation des tâches octroie aux hommes les activités les plus rudes qui nécessitent une forme d’intelligence différente de celle des femmes.
Les hommes chassent, ramassent les végétaux, préparent les outils de la chasse, etc. La chasse, la pêche, la guerre occasionnent des accidents, lesquels requièrent l’utilisation d’outils, de lames, de suture, du feu, etc. Cette prise en charge est assurée par les hommes parce que ces soins nécessitent une force physique qui est l’apanage des hommes qui sont plus grands et plus forts. Ainsi, ils découvrent et explorent l’intérieur du corps.
Quant aux femmes, elles récoltent les végétaux, sélectionnent les plantes en fonction de leur maturité et découvrent de façon empirique les vertus thérapeutiques des plantes qu’elles se transmettent par tradition orale. Elles préparent les aliments pour qu’ils puissent être consommés, imaginent comment et avec quels ustensiles les servir, les manger, etc. Elles ont aussi la charge des soins aux enfants, aux malades et aux mourants, auprès desquels elles assurent les soins du corps et les pratiques alimentaires. C’est la femme, forte de son expérience personnelle et de ce que son corps a vécu, qui peut prendre soin des autres.
Cette organisation structure la vie du groupe et génère des réactions telles que : plaisir, déplaisir, convivialité, entraide, partage, etc. Ainsi s’organisent les connaissances, les rites et les croyances avec des attributions de rôles distinctes selon le sexe. Ce sont les savoirs empiriques, nés de l’expérience de l’individu et du groupe, qui sont transmis de génération en génération. Leur diversification est liée aux expériences successives, qui permettent de faire face à ces situations de vie.
Un autre aspect vital requiert toutes les préoccupations, celui de s’adapter à son environnement. Se protéger des prédateurs, des rudesses du climat, avoir un endroit où se reposer, être en sécurité, prendre soin des outils, conserver les produits de la chasse, utiliser les plantes, s’occuper des animaux, des récoltes devient indispensable. Ces préoccupations donnent sens aux pratiques du corps – pratiques vestimentaires et d’entretien – et aux pratiques de l’habitat autour desquelles se créent la famille et les pratiques sexuelles.
Dès lors, la vie s’organise, il devient indispensable d’en prendre soin et de la préserver. De ce fait, « soigner, veiller à, représente un ensemble d’actes de vie qui ont pour but et pour fonction d’entretenir la vie des êtres vivants en vue de leur permettre de se reproduire et de perpétuer la vie du groupe2 ».
Ces étapes fondamentales surmontées, il faut affronter les autres réalités de la vie, la naissance, la maladie, la mort et y faire face. Ces nécessités donnent lieu à un ensemble d’activités indispensables prises en charge par les hommes et par les femmes, appelées « savoir-faire », lesquels sont acquis par tâtonnements, essais, erreurs.
C’est autour de ces nécessités vitales que se constituent les premiers savoirs qui donnent naissance à des pratiques courantes pour assurer la continuité de la vie.
Cependant, certaines situations étant inexpliquées par la connaissance qu’il possède, l’homme a recours au spirituel, aux explications métaphysiques ; c’est ainsi qu’apparaissent des notions telles que le bien et le mal, la conjuration des mauvais sorts, la dénonciation du mal, dont la charge est confiée aux shamans, aux prêtres qui font office de médiateurs avec le surnaturel. Le prêtre, qui est le gardien des traditions, est reconnu comme le médiateur entre les forces bénéfiques et maléfiques. Le médecin, descendant des prêtres, devient le spécialiste de l’identification des signes du mal dont le malade est porteur. Son rôle ira grandissant avec la progression des découvertes médicales.
Mélange de sorcellerie, de magie et d’explication divine, les savoirs transmis deviennent des rites perpétuels qu’il convient de respecter.
L’écriture est le point de départ de la formalisation de ces savoirs acquis de l’expérience, du questionnement, du doute. Les prêtres, les shamans, bref les personnes cultivées sachant lire et écrire consignent les connaissances apportées par les hommes. Peu à peu, sous l’influence des religions, ils imposent leur suprématie. Le personnage du médecin apparaît ; il devient le médiateur, il peut constater et interpréter les signes du corps, qu’il cherchera à explorer.
Cette formalisation scinde la connaissance. Ainsi s’affirme la supériorité des gens lettrés, notamment les médecins qui, par leur accès à l’écriture et à la lecture, s’approprient les savoirs « scientifiques ». Ces savoirs écrits sont appris et appliqués pour lutter contre la maladie. Leur pratique passe par l’utilisation d’outils nécessitant force et robustesse. Les soins du corps blessé, nécessitant suture, incision, réduction de fracture, exploration, relèvent de la compétence de l’homme, ce qui explique une orientation masculine.
Par opposition, les savoirs empiriques de la vie quotidienne sont nécessaires pour perpétuer la vie. Ils deviennent l’apanage des femmes. Ces soins des femmes accompagnent les étapes de la vie. Nombreux à la naissance et durant l’enfance, ils vont en décroissant à l’âge adulte, pour s’intensifier à nouveau lors de la vieillesse.
C’est ainsi que « les soins » et « soigner » prennent deux orientations distinctes : d’une part, assurer la continuité de la vie, et d’autre part, restaurer la santé. Peu à peu, soigner revient à traiter la maladie, et les liens tissés entre l’homme et son environnement, voire son groupe social pour perpétuer la vie sont mis à mal, seul le corps malade est considéré.
 Rôle des femmes
Rôle des femmes
Les acteurs des soins se dissocient. Les hommes chargés de l’exploration du corps et de sa réparation développent des technologies de plus en plus précises qui serviront également à d’autres corps de métiers. Ils deviendront barbiers et chirurgiens. Les femmes, quant à elles, assurent tous les soins en lien avec les différentes étapes de la vie, la fécondité et le développement de la personne.
Soigner, c’est aussi se poser des questions sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais pour repousser la maladie et la mort.
 Vieilles femmes
Vieilles femmes
Jusqu’à l’affirmation du christianisme comme religion d’État, les pratiques soignantes des femmes consistent à donner les soins corporels par différents moyens. Elles ont recours aux plantes pour soulager les maux, pour réaliser des préparations alimentaires, des breuvages désaltérants, des repas mêlant différents végétaux et produits naturels et dont les consistances peuvent s’adapter aux différents âges de la vie. Ces pratiques alimentaires, composantes vitales, servent également de médicaments par l’alchimie des plantes utilisées. Par ailleurs, les femmes prodiguent des soins concourant à protéger le corps des agressions, tels que les bains, le change du linge. Elles utilisent les pratiques de massage pour soulager et pour relaxer. Elles appliquent des soins de beauté.
Ainsi, « pendant des siècles, les femmes ont été des médecins autodidactes sans diplôme ; n’ayant pas accès aux livres et aux cours, elles firent elles-mêmes leur propre enseignement, se transmettant leur expérience de voisine en voisine, de mère en fille3 ».
Ces pratiques de soins traditionnelles respectent l’harmonie entre le corps, l’esprit et l’environnement.
La valeur sociale des soins donnés par les femmes est directement liée à l’expérience vécue dans leur propre corps. Aussi, seule la maiä, c’est-à-dire la grand-mère, peut devenir femme qui aide. Ainsi, ce sont les vieilles femmes qui dispensent les soins.
 Femmes consacrées : les religieuses
Femmes consacrées : les religieuses
L’arrivée du christianisme modifie radicalement la pratique soignante. Les connaissances en lien avec les mystères de la nature sont suspectes, le corps est jugé comme impur ; de ce fait, les soins du corps sont méprisés car considérés comme charnels. Les femmes soignantes sont des impies qui perpétuent des rites païens, ce qui va à l’encontre de la croyance chrétienne. Ainsi identifiées comme sorcières, ces femmes sont marginalisées, pourchassées, bannies, condamnées et doivent périr. Ce sont les prêtres qui s’approprient la connaissance, identifiant le bien et le mal. C’est la suprématie de l’esprit sur le corps et les soins deviennent spirituels. Le corps est dissocié de l’âme. Il faut connaître la souffrance physique pour se racheter et seule une personne ayant renoncé à elle-même peut donner ces soins.
Les pratiques soignantes sont alors sous l’égide de l’Église ; moines et religieuses sont les détenteurs des pratiques permettant de soigner l’âme. On parle alors des femmes consacrées (religieuses ayant fait don de leur virginité et de leur âme à Dieu) et de leur vocation. Ainsi, les pratiques de soins du corps (hygiène, massage, etc.) sont délaissées ; priment le discours, la morale, le conseil, les recommandations, etc. Les religieuses prodiguent des soins aux pauvres, aux malades et aux souffrants dans le but de racheter leur âme. Elles ne peuvent pas concilier les soins avec l’environnement de ces gens car elles ne peuvent pas aller dans le monde de l’impur. Les indigents et les malades viennent dans les lieux de soins ; c’est l’apparition des hospices et des hôpitaux.
 Auxiliaires médicales : garde-malade et infirmière4
Auxiliaires médicales : garde-malade et infirmière4
Avec la séparation de l’Église et de l’État en 1905 apparaît le personnage de l’infirmière. L’infirmière garde la vocation de servir les pauvres, les malades, mais les découvertes en sciences physiques et chimiques font progresser la médecine et les pratiques soignantes se trouvent modifiées. Les activités médicales s’amplifient et permettent le diagnostic et le traitement des maladies. Le médecin utilise de plus en plus de techniques élaborées et il lui est nécessaire d’être secondé. Il délègue les tâches quotidiennes qu’il a l’habitude d’exécuter lui-même (prise de la température, analyses d’urines, lavements, etc.) à une main-d’œuvre dévouée qui n’a d’autre intérêt que d’être au service du malade. Ainsi se construit la pratique soignante, être au service du malade et servir le médecin.
L’évolution technologique et notamment les découvertes pasteuriennes de l’asepsie et de l’antisepsie annoncent des bouleversements majeurs dans la pratique médicale. Il est alors nécessaire d’avoir du personnel compétent. Aussi, pour assurer la formation de ces aides subalternes, apparaît la première école d’infirmières créée sous l’impulsion du Dr Bourneville à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris en 1878. Y accèdent les personnes désirant donner des soins, recrutées dans un contexte de laïcisation. Progressivement, elles remplacent les religieuses. Les médecins élaborent le contenu de leur formation afin de les initier aux connaissances indispensables (anatomie, hygiène, techniques de soins, etc.) pour qu’elles puissent assurer les soins délégués et être fiables dans les observations qu’elles réalisent. De ce fait, on comprend que la formation soit orientée par les deux attitudes attendues du personnel soignant : servir le malade et le médecin.
Servir le malade est une mission infirmière répondant aux « qualités » féminines : vocation, soumission, délicatesse, suppléance envers le malade.
Servir le médecin, c’est appliquer l’enseignement dispensé et exécuter les consignes données sans remise en question. Dans ce contexte, la pratique infirmière est largement empreinte de valeurs morales.
Cependant, l’infirmière voit son champ d’action se développer de plus en plus du fait de l’essor de la médecine et de la nécessité pour le médecin de se rendre au domicile des personnes.
L’histoire de l’évolution de la condition féminine, et donc la place de la femme dans la société, contribue à accroître l’autonomie intellectuelle de l’infirmière. Pour échapper au discours moralisateur, elle va investir dans la technicité pour prolonger l’action médicale et revendiquer un rôle paramédical du fait de l’acquisition de compétences techniques. C’est ainsi que les soins relevant du rôle médical prennent de la considération et que toutes les autres pratiques autour des soins du corps, relevant davantage du rôle moral et social, perdent leur raison d’être.
Cette évolution dans les pratiques soignantes est dépendante de l’histoire même de la médecine et des courants culturels des époques traversées.
HISTOIRE DE LA MÉDECINE
Tout au long de l’histoire de la médecine dans le monde, c’est le corps malade qui interpelle et qui requiert toute l’attention. Abordée avec rationalité et irrationalité, la médecine offre une place prépondérante aux hommes, celle des femmes reste secondaire.
Comme nous venons de le voir précédemment, l’art de soigner est aussi ancien que l’humanité puisqu’il a facilité l’adaptation des hommes et de leurs civilisations à leur environnement pour survivre. Cependant, la médecine ne compte que quelques millénaires d’existence et n’a atteint une véritable reconnaissance que depuis moins de 200 ans, et ce en lien avec l’évolution des connaissances et des habiletés de ceux qui l’exercent. Initialement considérée comme un art, elle devient progressivement une science en s’appuyant sur les savoirs, les techniques et les découvertes qui découlent de la mise en évidence de lois fondamentales. Depuis, son développement et ses progrès se réalisent à une vitesse étonnante et se poursuivent encore de nos jours.
L’approche chronologique et géographique utilisée dans la suite de ce chapitre situe les grandes périodes de l’histoire de la médecine avec leurs caractéristiques culturelles et médicales ainsi que les principales découvertes qui ont marqué chacune de ces époques.
 Médecine de l’Antiquité5
Médecine de l’Antiquité5
Pour lutter contre les affections dont les causes matérielles sont indiscernables, toutes les médecines dites « archaïques » font appel à la magie, à la prière et à la divination. La maladie est considérée comme une sanction surnaturelle infligée à l’individu par une puissance démoniaque ou divine sur laquelle seuls les sorciers, les prêtres, les devins, encore appelés « shamans », peuvent intervenir car ils possèdent le pouvoir exceptionnel d’entrer en rapport avec les puissances surnaturelles. Cette conception a survécu jusqu’à nos jours dans certaines peuplades primitives et dans certains milieux arriérés ou mystiques.
C’est en Mésopotamie et en Égypte qu’on observe un timide pas vers la laïcisation de la médecine, dissociant la médecine divine de la médecine humaine, sans pour autant en évincer une au profit de l’autre.
 Mésopotamie
Mésopotamie
 Rappel historique
Rappel historique
Quatre civilisations se succèdent de 4000 à 539 avant J.-C.
Située entre les cours du Tigre et de l’Euphrate, la Mésopotamie est considérée comme le berceau de la civilisation pour plusieurs raisons. La fertilité de ses terres a favorisé son développement, sa richesse, une vie sociale importante autour des plantations de céréales, et la domestication d’animaux (9000 ans avant J.-C.). Ses invasions successives ont influencé la culture et enrichi cette civilisation : organisation de cités-États, création des systèmes d’irrigation, apparition des systèmes d’écriture et création d’un code juridique.
 Médecine
Médecine
Pour les Mésopotamiens, l’homme est déterminé par la précarité et l’absurdité de sa condition. Il est fait pour servir les dieux. La maladie est considérée comme une offense à une divinité, et le prêtre médecin doit découvrir la faute commise et en obtenir l’expiation.
La médecine est exercée par deux spécialistes. L’un, « expert magique », se charge de l’approche surnaturelle et irrationnelle de la maladie ; l’autre aurait une approche plus rationnelle pour guérir.
Le premier effectue un interrogatoire pour rechercher la transgression. Il décrit des signes cliniques, établit le diagnostic d’un certain nombre d’affections. Les examens complémentaires consistent en l’observation du vol des oiseaux, des fumées dégagées lors de la combustion de la farine, des viscères d’animaux sacrifiés, des astres et des rêves.
Le second, responsable du traitement, propose les prescriptions. La thérapeutique est magique et nécessite la mise en place d’un rituel avant, pendant et après l’usage de remèdes végétaux, minéraux ou animaux, dispensés sous forme de potions, d’inhalations, d’emplâtres ou d’instillations. Il réduit également les fractures, draine les abcès, préconise l’isolement des malades, etc.
La médecine mésopotamienne est décrite dans un traité listant les diagnostics et les pronostics, le Traité de diagnostics et pronostics. Le premier code de déontologie date de 282 avant J.-C. Le médecin prête alors serment. Le chirurgien barbier, pour sa part, fait partie de la corporation des artisans.
 Médecins
Médecins
Les médecins ont un statut défini et exercent différentes fonctions. Certains vont au domicile du malade et posent le diagnostic, d’autres sont devins ou exorcistes, ils assurent « la guérison ». Quand le malade ne peut être guéri, aucun recours au divin n’est proposé si les moyens rationnels ne sont pas efficaces.
 Égypte
Égypte
 Rappel historique
Rappel historique
La civilisation égyptienne dure 3 000 ans, de 3100 à 332 avant J.-C., date de la conquête de l’Égypte par Alexandre. En 30 avant J.-C., l’Égypte passe sous domination romaine.
 Médecine
Médecine
L’âme égyptienne est marquée par l’espérance et la joie de vivre, à l’inverse des enfers et des ténèbres promis à Babylone. Les hommes sont voués à une félicité éternelle. La maladie est la possession du corps par un dieu, un mort ou un ennemi.
De nombreux écrits médicaux ont été retrouvés, notamment sur des papyrus. Ils révèlent des informations relatives à la gynécologie, à la chirurgie, à la proctologie et aux différentes thérapeutiques. Ces connaissances sont probablement induites par la pratique de l’embaumement, qui nécessitait l’éviscération et donc le développement de connaissances en anatomie. Cependant, les connaissances en physiologie demeurent sommaires et inexactes. Il faut attendre le XVIe siècle pour mieux l’appréhender.
L’exercice de la médecine est codifié. Les médecins établissent des diagnostics suite à un recueil d’informations, à un examen clinique et à l’observation des excrétas (urines, selles, crachats). Néanmoins, ils ne font pas de pronostic puisque la guérison relève de la volonté des dieux. L’examen du malade comprend : interrogatoire, inspection, palpation, percussion, auscultation. Le médecin prononce des incantations en appliquant des remèdes médicaux, utilise des amulettes et des statues guérisseuses.
Quelques signes sont regroupés en syndromes (insuffisance cardiaque, angine de poitrine, etc.) et certaines descriptions et annotations retrouvées dans les papyrus démontrent l’avancée des connaissances : description des complications neurologiques des traumatismes cervicaux (tétraplégie, troubles sphinctériens), utilisation de tampons vaginaux contraceptifs à base de latex, suture des plaies à l’aide de « catgut » (dont la signification est « boyau de chat »).
L’hygiène publique est relativement bien développée, pour lutter contre les infections microbiennes et parasitaires.
Pour soigner, les médecins ont recours à l’utilisation de drogues d’origine végétale, animale et minérale, qui sont administrées sous forme de comprimés, pommades ou fumigations.
Le premier papyrus médical, acheté par Ebers (égyptologue allemand) à un Égyptien en 1872, date de 1550 ans avant J.-C. et est long de 20 mètres. C’est le plus ancien traité de pharmacologie. Il explore les maladies en les classant de la tête aux pieds.
Les papyrus sont conservés dans des temples par les prêtres parce que les textes médicaux doivent être tenus secrets. Il faut attendre 1822, date à laquelle Champollion décrypte les hiéroglyphes, pour que ces connaissances soient divulguées.
 Médecins
Médecins
Les médecins ont une grande renommée et occupent une place reconnue dans la société. Ils sont le plus souvent spécialisés ; ainsi, il existe des spécialistes de l’anus, de la bouche et des dents, des yeux, de l’abdomen, etc.
Les médecins soulignent la fonction des poumons, connaissent l’anatomie du cœur et pressentent son rôle ainsi que celui des vaisseaux. Le papyrus d’Ebers décrit « la danse du cœur » mais confond les vaisseaux avec tous les autres canaux excréteurs et les relie tous au cœur. Le cœur est le siège de l’intellect et de la pensée.
Pour sa formation, le médecin fait un stage dans une maison de vie, lieu d’activité intellectuelle, culturelle et centre de documentation. Il est spécialisé et dispose de manuels d’enseignement écrits sur des papyrus et des poteries.
 Grèce
Grèce
 Rappel historique
Rappel historique
La médecine grecque, comme l’ensemble de cette civilisation, a une grande influence sur nos modes de pensée et les Grecs sont considérés comme les fondateurs de la médecine moderne. À partir du VIIIe siècle avant J.-C., la civilisation hellénique domine le monde méditerranéen autour de deux cités : Athènes et Sparte. Indépendantes et souvent rivales, elles s’unissent pour combattre leur puissant voisin, l’empire perse.
Les mathématiciens développent une philosophie de la vie et de l’univers par l’observation et l’expérience (Socrate, Pythagore, Platon, Aristote, Archimède). Ils se posent des questions sur l’origine de l’homme et de l’univers, certains évoquent une théorie de l’évolution. Empédocle pense qu’à l’origine des êtres monstrueux s’assemblent et deviennent des êtres plus équilibrés.
Les Grecs ont le sentiment d’appartenir à une civilisation originale faite de liberté et de sagesse et, pour eux, les non-Grecs sont considérés comme des êtres barbares.
 Médecine
Médecine
La médecine cherche à se défaire de l’influence de la religion et de la magie pour expliquer de façon logique les faits observés. Les connaissances en anatomie sont relativement correctes. Néanmoins, les connaissances en physiologie restent sommaires et inexactes, marquées par la théorie des quatre éléments (terre, eau, air, feu) et des quatre humeurs (sang, bile, bile noire et phlegme).
La maladie est vue comme résultant de facteurs internes liés à un déséquilibre des humeurs et de facteurs externes tels le climat, l’environnement et le régime.
Les humeurs sont représentées par :
– le sang (élaboré au niveau du cœur) dit « chaud et humide » ;
– la bile (jaune, sécrétée par le foie) dite « sèche et chaude » ;
– l’atrabile (bile noire appelée « méléna ») dite « froide et sèche » ;
– le phlegme (écoulement nasal, crachats, glaires intestinales, liquide céphalorachidien, liquides sécrétés par l’hypophyse donc venant du cerveau, d’où l’expression « rhume de cerveau »).
Les facteurs extrinsèques sont représentés par les saisons, les eaux, l’air, les vents.
Les facteurs intrinsèques correspondent aux âges de la vie, aux facteurs congénitaux ou génétiques ou constitutionnels ainsi qu’aux facteurs raciaux.
La démarche médicale procède par étapes : établissement du diagnostic après examen du malade, formulation d’un pronostic et enfin proposition d’un traitement qui ne vise qu’à seconder la nature dans le processus de guérison. On utilise peu de médicaments ; l’essentiel est constitué par des prescriptions qui visent le régime et l’hygiène de vie.
La médecine grecque s’élabore en quatre périodes.
– La première, la période mythologique, considère la maladie comme une punition divine où les dieux ont le pouvoir de guérir ou de provoquer les maladies. La médecine est exercée dans des temples et Apollon est le dieu de la médecine, Hygie la déesse protectrice de la santé (médecine préventive) et Panacée celle qui guérit les malades (médecine curative).
– La deuxième, dite période philosophique et savante, se caractérise par la dissociation de la médecine et de la magie par des philosophes savants qui cherchent à raccorder les lois de la physique et de la chimie à la physiologie humaine et à expliquer les phénomènes constatés.
– La troisième, dite période hippocratique, est caractérisée par une nouvelle conception : les maladies ont une cause naturelle et non plus surnaturelle, cause que l’on peut expliquer et comprendre. Les maladies ont une origine environnementale qu’il faut découvrir. La santé est la résultante de l’équilibre des humeurs et la maladie est la rupture de cet équilibre.
– La dernière, post-hippocratique, correspond à la création d’une multitude d’écoles et de sectes médicales développant des concepts opposés.
La médecine devient un art indépendant des pratiques religieuses et elle considère la maladie comme étant liée à des phénomènes extrinsèques et intrinsèques. La notion de lésion d’un tissu ou organe par un agent quelconque est inconnue ; la maladie est vue comme une atteinte globale de l’organisme.
La pharmacopée repose sur l’usage de substances minérales (cuivre cicatrisant des lésions buccales, alun antiulcéreux, etc.) et végétales (orge antipyrétique et antidiarrhéique, raisin ou miel anti-infectieux des plaies, etc.). Les interventions chirurgicales sont nombreuses, peut-être grâce à l’usage d’anesthésiants et d’analgésiques issus de la mandragore et du pavot. Elles consistent en des excisions de tumeurs et des incisions diverses.
 Médecins
Médecins
D’abord itinérants, les médecins se sédentarisent dans des maisons médicales où ils sont assistés par des esclaves et des étudiants.
Hippocrate reste l’un des médecins les plus connus grâce aux connaissances qu’il a écrites et/ou regroupées avec des disciples du courant de pensée dont il est à l’origine. Ce courant a traversé les époques pour être encore aujourd’hui d’actualité par le respect du malade qu’il prônait et surtout le fait de veiller à ne pas lui nuire.
Hippocrate (460–377 av. J.-C.), fils et petit-fils de médecin, reçoit une éducation complète (philosophie, physique, géométrie, astronomie, etc.) et un enseignement de la médecine par son père et par des maîtres. Il approfondit ses connaissances en voyageant et fait la synthèse de toutes les connaissances médicales qu’il découvre. Il laisse 60 traités médicaux. Il établit les principes théoriques de la médecine et fonde l’école de l’île de Cos.
Il instaure l’examen du malade pour rechercher des signes généraux et locaux, l’interrogatoire à la recherche des antécédents et l’étude de l’évolution de la maladie en cherchant à établir un pronostic. Il établit les phases d’évolution de la maladie : incubation, phase critique et résolution. Il prescrit les traitements qui comprennent des mesures hygiéno-diététiques, les saignées et les ventouses scarifiées, les vomitifs, les purgatifs, les lavements, les bains chauds ou froids, les cataplasmes, l’application de compresses, les tisanes.
Il relie la pratique médicale à la philosophie et à la morale, et donne naissance à l’éthique. Le devoir du médecin est ainsi clairement défini : il doit soulager et vise à aider la nature à rétablir l’équilibre.
L’éthique est une dominante de l’exercice médical ; l’attitude du médecin doit être irréprochable vis-à-vis du patient comme de sa famille. Le médecin doit prendre soin de lui et être en bonne santé.
Son exercice est régi par le serment d’Hippocrate dont les médecins actuels ont hérité. Ce serment est composé de deux types de consignes : les assertions et les interdits qui constituent les fondements de l’éthique médicale. Les deux conceptions mises en évidence sont de proscrire tout risque de nuire et de taire ce qui ne doit être divulgué. Ainsi, la notion du secret médical apparaît comme absolue, le sort du malade est reconnu comme prioritaire.
Les quatre principes de cette éthique sont :
– l’intérêt du malade, plus important que celui du médecin ;
– le refus d’accomplir des actes dangereux ;
Le serment d’Hippocrate régit les règles de la confraternité entre les médecins, l’égalité des hommes devant la maladie, la défense de la vie, le respect du secret médical :
– « je dirigerai le régime des malades à leur avantage » ;
– « je m’abstiendrai de tout mal, toute injustice » ;
– « je ne remettrai à personne du poison » ;
– « je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif » ;
– « dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur » ;
– « quoique je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas » ;
– « si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ».
 Empire romain
Empire romain
 Rappel historique
Rappel historique
Rome devient la « maîtresse du monde occidental » et va progressivement à partir du IIIe siècle avant J.-C. s’étendre en Italie puis à l’ensemble du bassin méditerranéen et à une partie de l’Europe. L’Empire romain règne jusqu’en 476.
 Médecine
Médecine
La pensée médicale romaine évolue autour de trois périodes : la médecine divinatoire, la médecine des médecins des sectes, la médecine galénique.
– La médecine divinatoire repose sur la divination après l’observation des viscères d’animaux.
– La médecine des sectes médicales est imprégnée de la culture grecque. Au cours de leurs conquêtes, les Romains côtoient les Grecs, plus cultivés et plus raffinés qu’eux, ce qui induit des modifications perceptibles dans leur approche de la médecine du fait des influences des philosophes, mathématiciens, anatomistes, etc. De ce fait, après la conquête de la Grèce, un grand nombre de médecins grecs s’installent à Rome et le statut social du médecin, jusque-là relativement bas, s’améliore progressivement.
– La médecine galénique est marquée par Galien, considéré, avec Hippocrate, comme l’un des plus grands médecins de l’Antiquité.
Au début de l’Empire romain, toute personne parlant le grec peut devenir médecin. Mais devant la valorisation de ce statut, l’organisation des études s’impose pour éviter l’apparition de pseudo-médecins. L’enseignement s’organise alors autour de médecins réputés et aboutit à la création d’écoles de médecine.
Les Romains développent l’hygiène publique en veillant à la propreté des rues, à la mise en place d’égouts, à l’alimentation en eau et à l’ouverture de bains publics. L’eau joue un rôle majeur ; c’est la naissance du thermalisme, qui perdure encore aujourd’hui. L’eau est utilisée en boisson (Galien attribue des vertus aux différentes eaux thermales), en bain, en douche générale ou locale ; elle est aussi associée à l’application de boues.
L’autre innovation consiste en l’apparition d’une main-d’œuvre féminine qui, par charité, par dévotion et par vocation, dispense des « soins ». C’est l’apparition, à l’aube du christianisme, des infirmières qui œuvrent dans les hospices.
 Médecins
Médecins
Il existe trois catégories de médecins : les médecins libéraux – ils exercent le plus souvent au sein des familles (parfois à titre d’esclave) ou dans des boutiques –, les médecins du gouvernement payés par l’État pour soigner les pauvres et les médecins militaires.
– Pline l’Ancien crée une œuvre qui recense les connaissances de son époque, soit 37 livres appelés Histoire Naturelle, dont quelques-uns traitent de la médecine et des remèdes.
– Celse écrit un ensemble de traités, Les métiers, dont seul celui consacré à l’art médical est découvert au XVe siècle. Il y rapporte toutes les connaissances de son époque et y évoque :
– les maladies, dont des affections psychiatriques (psychose hallucinatoire chronique, états dépressifs) ;
– la chirurgie, dont l’utilisation de lambeaux cutanés dans les plaies faciales avec perte de substance, la chirurgie de la hernie étranglée, la mammectomie, la ligature vasculaire ;
– Soranos, considéré comme le fondateur de l’obstétrique, reconnaît les différentes dystocies et sait manipuler le fœtus pour une présentation convenable. Il évoque la délivrance et note la nécessité de surveiller l’expulsion du placenta. Il pose les principes des soins aux nouveau-nés et aux enfants. Hostile à l’avortement, on lui doit des recettes de tampons vaginaux à visée contraceptive. Il écrit un Traité sur les maladies des femmes, destiné aux sages-femmes.
– Galien (129 ou 131–201), médecin grec installé à Rome (en 163 après J.-C.), est aussi le médecin des gladiateurs ce qui lui permet de développer des connaissances en anatomie. En disséquant des animaux, il extrapole à l’homme ce qu’il observe. Ses connaissances, quelquefois erronées, vont prévaloir jusqu’au XVIe siècle. Fidèle à Hippocrate, il impose sa théorie des humeurs et des tempéraments fondamentaux (le bilieux, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique). Il traite par les eaux chaudes ou froides, les cataplasmes, les purgatifs et les médicaments comme l’opium.
 Chine
Chine
À la même époque, la médecine de l’Orient asiatique atteint son apogée et est consignée dans de nombreux ouvrages. Ces derniers ont contribué par la suite à instruire une longue lignée de cliniciens, chirurgiens, hygiénistes, pharmacologistes, etc. Des acupuncteurs de talent attribuent les maladies à une anomalie du trajet de « l’énergie vitale » le long des « méridiens » ou à un conflit entre les deux forces immatérielles opposées du yin et du yang.
 Rappel historique
Rappel historique
De tout temps, la Chine a développé des connaissances scientifiques et médicales indépendamment de l’Occident, malgré les échanges forts anciens avec ce dernier. Une douzaine de dynasties s’est partagée le pouvoir ; la dernière, la dynastie des Qing, remplace les Ming en 1644.
Les idées fondamentales de la science chinoise reposent sur les cinq éléments que sont l’eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Chacun de ces éléments est associé à une saveur et à toutes les activités de la nature et de l’homme. Le yin et le yang représentent les principes fondamentaux de la philosophie taoïste chinoise ; le premier correspond à la passivité et le second à l’activité.
Le yin représente, entre autres, le noir (ou souvent le bleu), le féminin, la lune, le sombre, le froid, le négatif, etc. Quant au yang, il représente le blanc (ou souvent le rouge), le masculin, le soleil, la clarté, la chaleur, le positif, etc. Cette dualité est également associée à de nombreuses autres oppositions complémentaires.
 Médecine
Médecine
L’exercice de la médecine est strictement réglementé et les écoles de médecine sont fort anciennes. La médecine est principalement fondée sur des hypothèses et non sur des faits puisque la dissection du corps est interdite. Cette médecine repose sur l’existence des fluides contenus dans l’organisme, les humeurs.
La particularité de la médecine chinoise repose sur l’acupuncture qui date d’environ 600 ans avant J.-C. Son but est de rétablir l’équilibre entre le yin et le yang, le déséquilibre représentant la maladie.
Une autre particularité est l’étude des pouls, qui consiste en des prises de pouls en différents endroits du corps, chacun correspondant à un organe malade particulier. Ce bilan « pulsologique » est ensuite comparé à d’autres données, notamment celles recueillies au cours d’un entretien, de l’observation, de la palpation, de l’étude de la voix et du contexte sociologique du patient.
 Médecins
Médecins
Il existe cinq catégories de médecins : les médecins chefs qui ont la responsabilité de la préparation des médicaments, les médecins diététiciens, les médecins chargés des maladies banales telles que les migraines et les rhumes, les médecins des animaux, c’est-à-dire les vétérinaires qui pratiquaient l’acupuncture, et les professeurs de médecine qui forment les étudiants.
Les thérapeutiques chinoises sont très développées et utilisent principalement les plantes et accessoirement les insectes et les minéraux. Parmi les plus fréquentes, citons l’armoise, les feuilles de saule et le ginseng qui fait office de panacée.
 Moyen Âge
Moyen Âge
Le Moyen Âge est la période de l’histoire de l’Europe que l’on situe traditionnellement entre la date de la chute du dernier empereur romain d’Occident en 476 et la date de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. Cette période est caractérisée par l’effondrement de l’Empire romain et l’essor de l’islam.
 Empire byzantin
Empire byzantin
 Rappel historique
Rappel historique
L’effondrement de l’Empire romain donne lieu à la création de deux entités politiques : l’empire d’Orient (dit byzantin) avec pour capitale Constantinople et l’empire d’Occident avec pour capitale Rome. L’Orient byzantin et judéo-islamique perpétue la tradition médicale antique et l’enrichit. À Alexandrie (centre intellectuel né de la fusion de la culture grecque et orientale) s’établit une école de médecine prestigieuse qui permet l’émergence de nouvelles connaissances anatomiques.
 Médecine
Médecine
La médecine prend une orientation pratique dominée par la clinique et la thérapeutique. Deux courants de pensée philosophiques opposent les dogmatiques et les empiriques.
Les dogmatiques soutiennent que le raisonnement supplante l’observation. Deux anatomistes découvrent le système nerveux : les nerfs sensitifs et moteurs, le cervelet, le bulbe, les méninges, le cerveau. Ils différencient les veines et les artères. Ils relient les pulsations des artères aux battements cardiaques. Ils furent peu entendus. Le déclin de l’école d’Alexandrie entraîne pour plusieurs siècles la disparition de la pratique des dissections humaines.
Les empiriques refusent les concepts théoriques et les travaux anatomiques. Ils s’intéressent davantage aux traitements médicaux qu’aux causes des maladies. Ils mettent en avant qu’ils sont plus utiles que les médecins qui ne font que penser.
 Monde arabe
Monde arabe
 Rappel historique
Rappel historique
L’essor de l’islam à partir du VIIe siècle amoindrit le pouvoir du christianisme autour de la Méditerranée. Il se caractérise par un empire islamique créé depuis Damas et des scissions, avec la création de pôles à Bagdad, au sud de l’Espagne et en Égypte.
Les pays islamisés bénéficient de solides structures médicales, dans lesquelles exercent des figures marquantes de l’évolution de la médecine judéo-arabe : Isaac l’Hébreu (880–932), Avicenne (980–1037), etc.
En 711, l’Espagne est devenue musulmane et les musulmans envahissent le sud de la France. Ceux-ci sont arrêtés dans leur progression à Poitiers par Charles Martel. Les Arabes bâtissent un empire de l’Espagne jusqu’en Inde et tirent profit des connaissances déjà acquises.
Les pays convertis à l’islam développent un système d’assistance avec un centre social urbain comprenant la mosquée, l’hôpital, l’école théologique, la bibliothèque, les cuisines publiques et les bains.
Bagdad et Cordoue sont des centres de recherches scientifiques et les capitales de la médecine.
 Médecine
Médecine
La médecine arabe représente un stade fondamental de la pensée médicale du Moyen Âge, à la charnière entre la pensée gréco-romaine et la pensée occidentale.
La médecine arabe brille par ses connaissances en chimie qui lui permettent un développement de la pharmacopée (1400 médicaments). L’utilisation de l’alambic intervient dans la préparation des médicaments.
L’ophtalmologie constitue un domaine important de la médecine arabe, avec une connaissance précise de l’anatomie, des bases de l’optique physiologique, des différentes pathologies. En 1256, la première intervention grâce à une aiguille creuse permet la succion de la cataracte.
Les Arabes ont surtout participé à l’organisation et à l’enseignement de la médecine. En 932, il est obligatoire de posséder un diplôme pour exercer la médecine. Le futur médecin fréquente une école hospitalière et suit la pratique médicale d’un maître au lit des malades. Cependant, l’exercice de la chirurgie est considéré comme indigne ; de ce fait, elle est réalisée par un personnel subalterne. La religion interdit toute dissection humaine.
 Hôpitaux
Hôpitaux
Dès le VIIIe siècle apparaissent les maisons pour malades sur le modèle des établissements fondés par les chrétiens, mais le confort des malades est assuré par d’importantes donations. Il existe 8 hôpitaux à Bagdad et 40 dans le khalifat de Cordoue. Ils sont organisés en services spécialisés, avec à leur tête un chef de service. Le confort et l’hygiène des malades sont une priorité. Les lépreux sont isolés. Il existe aussi des centres pour aliénés dans lesquels la danse, la musique, le théâtre font partie de la thérapie (à Bagdad, Fez et au Caire) et des cliniques ambulantes pour soigner les populations rurales. L’hôpital possède un orphelinat et une bibliothèque.
Les hôpitaux sont aussi des centres de formation (à la même époque en Europe, il est l’asile des pauvres).
 Médecins
Médecins
– Rhazès (860–923), médecin passionné par l’étude des minéraux, développe une œuvre à la limite de la pharmacie et de l’alchimie. Grand clinicien, il est l’auteur d’un traité de 70 livres où sont réunies toutes les connaissances médicales du Xe siècle.
– Avicenne (980–1047) écrit un ouvrage de base, Le Canon de la médecine, qui est enseigné dans les facultés jusqu’au XVIIe siècle. C’est une encyclopédie de toutes les symptomatologies connues.
– Ibn an-Nafis (1210–1288) réfute la théorie de Galien et donne une description précise de la circulation sanguine. Néanmoins, il faut attendre Harvey en 1638 pour que sa théorie soit reconnue. Il laisse un traité recensant 2000 drogues. Son œuvre est découverte en 1930.
Les connaissances que ces médecins transmettent et qu’ils enrichissent parviennent en Europe occidentale grâce à des traducteurs tels que Constantin l’Africain (1015–1087), Gérard de Crémone (1114–1187) ou Arnaud de Villeneuve (1235–1311). L’héritage est propagé par les deux grandes écoles laïques de Salerne et de Montpellier. C’est par cette voie détournée que l’Occident redécouvre le patrimoine médical gréco-latin à la veille de la Renaissance.
 Europe occidentale
Europe occidentale
Alors que l’Empire byzantin se développe, l’Occident végète dans un long immobilisme dont il ne se dégage que dans les deux siècles qui précèdent la Renaissance. Dans le monde chrétien occidental (Europe occidentale), sous le contrôle sévère des autorités ecclésiastiques, la médecine demeure l’apanage des clercs et des prêtres, générant une période se caractérisant par l’absence de développement des connaissances et par l’obscurantisme. L’exercice de la médecine et l’assistance aux malades, considérés comme des œuvres pieuses, sont placés sous l’égide étroite de l’Église. Les premiers établissements hospitaliers apparaissent vers le IVe siècle et se multiplient par la suite.
À partir du XIIe siècle, une orientation nouvelle se dessine sous l’influence de l’apport oriental et sous l’impulsion des premières universités laïques de Bologne (1123), Padoue et Montpellier (1220).
Les maîtres français sont principalement des chirurgiens instruits par de rares dissections anatomiques réalisées malgré l’hostilité et la surveillance méfiante de l’Église : Henri de Mondeville (env. 1260–1320) et surtout Guy de Chauliac (1300–1368), qui font d’intéressantes constatations au cours de l’effroyable épidémie de peste noire (1348).
Fondée en 1253, la faculté de médecine de Paris ne permet aucune avancée scientifique tant les esprits sont contraints par les règles scolastiques et le dogmatisme d’un enseignement purement livresque. Alors que les civilisations orientales progressent, les conceptions physiologiques françaises reposent encore sur les principes de Galien ; le diagnostic d’un mal est posé sur l’allure de la fièvre, la qualité du pouls, l’aspect de la langue et des urines. La thérapeutique se borne à la prescription de préparations végétales, de drogues étranges ou magiques, de saignées profuses, de cautérisations ou de clystères (lavements). Les grands fléaux collectifs – peste et lèpre – suscitent une crainte quasi religieuse et accentuent le recours à de nombreux « saints guérisseurs » et à l’ésotérisme. Ce dernier prend d’ailleurs une forme nouvelle à la fin du XVIIIe siècle avec le « magnétisme » de Mesmer.
Les civilisations précédentes étaient fondées sur la matérialité de l’âme, mais pas nécessairement sur son immortalité. La civilisation médiévale est caractérisée par un recul de la notion de la chose publique, un morcellement de l’autorité et un système de pensée tributaire de la croyance religieuse aux mains des seuls doctrinaires de l’Église. Ainsi, le christianisme, né de la victoire du Christ sur la mort, de la promesse d’une vie éternelle, des miracles, des résurrections et de l’amour de son prochain, devient la référence prépondérante. L’Europe se définit comme chrétienne avec un chef, le pape. L’Église encadre le futur et assoit son pouvoir. Elle crée des monastères dans les campagnes qui permettent aux monastiques de fuir ce monde qui vit dans le péché. Le pèlerinage fait partie des devoirs du chrétien, les hospices jalonnent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, avec la création d’ordres religieux hospitaliers. Les évêques récupèrent le pouvoir laissé par l’administration romaine et deviennent les chefs des villes et des villages. La culture et l’élevage nomade disparaissent au profit de la création de villages autour des églises et des cimetières. La société est partagée en trois ordres : la noblesse, le tiers-état et le clergé.
 Hôpitaux
Hôpitaux
À partir du IVe siècle, l’officialisation du christianisme favorise l’émergence d’ordres religieux, et la pauvreté qui inspire les règles monastiques fait figure de vertu. Le pauvre est, à l’image du Christ, une source de rédemption. Les différents conciles imposent aux évêques de nourrir et de vêtir les pauvres et les inaptes au travail.
L’hôpital est ouvert aux pauvres et à tous ceux qui ont besoin d’assistance. Il accueille aussi les voyageurs et les pèlerins. Les premiers hôpitaux, appelés Maisons Dieu ou Hôtels Dieu, sont fondés dans les cités par les évêques ; celui de Paris est créé en 829.
Les dons et les legs permettent aux établissements de fonctionner et de se constituer un patrimoine immobilier. Pour assurer leur fonctionnement, ces structures ont aussi besoin de main-d’œuvre ; celle-ci est constituée par différents personnels et serviteurs à gage. Parmi eux, des prêtres assurent le culte des « donnés », c’est-à-dire des enfants abandonnés, et des religieux s’occupent des tâches administratives. Enfin, des religieuses assurent les soins. Jusqu’au IVe siècle, les médecins et les chirurgiens sont absents de ces établissements.
 Médecine
Médecine
Galien et Hippocrate, deux grandes figures de la médecine de l’Antiquité, ont marqué durant 14 siècles la théorie et la pratique médicales. Il faut attendre la Renaissance pour que leur savoir soit remis en cause.
La médecine occidentale se développe en deux temps, la période monastique et la période scolastique.
La période monastique (600–1100)
À la suite des invasions barbares, l’Europe s’unifie autour de la religion. Les monastères sont les conservatoires des manuscrits anciens et la médecine le domaine des moines. Celle-ci bannit les savoirs des civilisations précédentes (grecque, romaine, arabe). Tout essai de révision ou de discussion est considéré comme hérétique.
La médecine attribue le nom d’un saint à la plupart des maladies et la guérison est recherchée à travers le culte des reliques de saints et par les pèlerinages (Rome, Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle), sur les lieux où se trouvent ces reliques ou les tombes des saints. Auprès des églises se développent des structures d’hébergement tenues par des femmes. Il est interdit à tout ecclésiastique de pratiquer la chirurgie et la dissection de cadavre sous peine d’excommunication. Les chirurgiens, les barbiers, les arracheurs de dents et les sages-femmes sont mis à l’écart. En 1163, un concile condamne la pratique de la chirurgie.
La période scolastique (1100–1400)
Cette période est marquée par le développement des écoles et des universités, avec une ouverture sur le monde. Sous l’influence des connaissances de la médecine arabe, la médecine acquiert progressivement le statut de science.
Cependant, différents conciles interdisent aux moines la pratique de la médecine car celle-ci les détourne de leur activité spirituelle. Soigner les hommes et les femmes risque de rendre difficile le respect de leurs vœux de pauvreté et de chasteté. Cette évolution favorise la laïcisation de la médecine.
Au XIe siècle, à Salerne, en Italie, les moines bénédictins fondent un hôpital puis une école de médecine, avec la possibilité pour les laïcs et les femmes d’y étudier. Salerne devient le confluent du monde chrétien et arabe, avec un regain pour l’étude des textes grecs et latins. Les études durent 5 ans.
Les connaissances médicales acquises ouvrent la voie de la création d’universités à Padoue, Bologne, Pavie, Naples, Cordoue, Séville, Tolède, Salamanque, Montpellier, Toulouse et Paris. À Montpellier, les étudiants suivent un enseignement d’une durée de 5 à 6 ans. Ils étudient les connaissances transmises par Hippocrate, Galien, Avicenne et par certains médecins juifs et arabes. L’université contrôle l’exercice de la médecine et surveille les activités des barbiers. À Paris, les étudiants effectuent un stage pratique l’été.
Au début du XIVe siècle, à Bologne, la pratique de la dissection sur les cadavres humains reprend sans remettre en question les descriptions de Galien. C’est à partir de 1396 qu’une lettre de Charles VI donne droit à l’université de Montpellier de disséquer une suppliciée par an. Les facultés sont des lieux rares, principalement urbains, alors que les besoins médicaux se manifestent partout.
La séparation est marquée entre les médecins instruits, latinistes, formés dans les facultés, exerçant pour une clientèle aisée et les chirurgiens qui traitent les maux de la population. Les barbiers chirurgiens cherchent à faire reconnaître leur valeur en se regroupant. Le collège de Saint-Côme est créé à Paris en 1230. Il y est rédigé des statuts définissant l’exercice des barbiers chirurgiens pour se démarquer des barbiers illettrés. La confrérie obtient l’autorisation de définir les conditions d’exercice des chirurgiens, réduisant ainsi celui des barbiers à la saignée, au traitement des abcès et des plaies.
Au XIIe siècle apparaissent en Europe les premiers apothicaires. Saint Louis leur donne un statut en 1258 en leur autorisant la préparation et la vente des médicaments. Ils se séparent réellement des épiciers (vendeur d’épices) en 1514.
Une médecine parallèle développe l’alchimie et l’astrologie pour combattre des « forces secrètes » par la recherche de l’or, de la pierre philosophale et de l’élixir universel.
Durant le Moyen Âge, des maladies graves et contagieuses envahissent régulièrement l’Europe. Ainsi, la peste qui sévit en 1342 décime en 5 ans le tiers de la population européenne, faisant 50 000 morts à Paris où l’on dénombre jusqu’à 500 décès par jour à l’Hôtel-Dieu. La peste survient de manière endémique tous les 10 à 12 ans.
La lèpre est en recrudescence et les malades atteints sont considérés comme incurables. Ils reçoivent le sacrement des morts et doivent regagner la léproserie (ou maladrerie) munis d’une crécelle prévenant les personnes saines de s’écarter de leur chemin. L’ordre religieux de Saint-Lazare se consacre aux soins des lépreux. La France compte 2000 établissements, soit 60 0000 malades. Cette maladie disparaît de l’Europe au XVIe siècle sans qu’aucune raison ne puisse l’expliquer.
 Médecins
Médecins
Deux chirurgiens marquent particulièrement le Moyen Âge.
– Henri de Mondeville (1260–1320 ?), chirurgien des armées, développe le principe du parage des plaies ainsi que la pose de pansements humides favorisant l’élimination du pus de ces plaies.
– Guy de Chauliac (1298–1368) revendique l’unité entre les pratiques médicales et chirurgicales. Son ouvrage Grande Chirurgie marque la pratique pendant quatre siècles. Il recense tous les savoirs, s’ouvre sur l’expérience et affirme l’importance de la connaissance de l’anatomie.
 Temps modernes
Temps modernes
 Renaissance (1450–1590)
Renaissance (1450–1590)
 Rappel historique
Rappel historique
La Renaissance est une période qui marque le début des temps modernes. Elle est caractérisée par la découverte du Nouveau Monde en 1492 et l’invention de l’imprimerie, avec l’utilisation des caractères mobiles qui révolutionnent la diffusion des connaissances. Celle-ci est facilitée par l’instauration progressive de l’usage du français au détriment du latin. Cette époque est aussi marquée par une poussée démographique ainsi que par le développement de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat urbain (textile, orfèvrerie, armurerie, imprimerie).
L’écart se creuse entre une pauvreté idéalisée à l’image du Christ et une pauvreté matérielle qui commence à apparaître comme objet de crainte, de mépris et donc à être considérée comme un réel danger social. Peste, guerres, crises économiques mettent les hôpitaux en difficulté. L’afflux des pauvres dans les villes s’intensifie. Les mendiants acquièrent une mauvaise réputation, d’autant qu’éclatent des émeutes. L’Aumônerie Générale, créée en 1534 dans les villes, collecte les aumônes, déclare la guerre à la mendicité dans les rues, dépiste les malades pour les faire soigner et fait travailler les miséreux à l’hôpital.
Sur le plan religieux, les chrétiens se divisent en catholiques et protestants. Martin Luther remet en cause la mission d’assistance aux pauvres et aux malades qui favorise l’enrichissement de l’Église grâce à ses bienfaiteurs. Il prône une charité chrétienne quotidienne et individuelle. Dans les pays germaniques, beaucoup d’hôpitaux passent sous le contrôle de l’État et des municipalités. Les autorités laïques de certains pays confisquent ses biens à l’Église, tel Henri VII en Angleterre qui dissout les ordres religieux.
Foisonnement d’idées, remises en cause de l’autorité morale de l’Église par des groupes d’intellectuels, telles sont aussi les caractéristiques de cette période.
 Médecine
Médecine
La profession est réservée aux laïcs à condition d’être titulaire d’un doctorat. Le statut, les droits, les obligations des médecins sont codifiés.
L’anatomie évolue avec la pratique et l’enseignement des dissections ; elle est enrichie par la contribution d’artistes peintres et sculpteurs tels Léonard de Vinci, Albrecht Dürer, Raphaël et Michel-Ange. La principale avancée est la rectification des erreurs du passé. En effet, les premiers anatomistes s’attachent à préciser la structure interne du corps humain et à étudier son fonctionnement. Cette attitude a le mérite de questionner les savoirs et de réformer l’anatomie.
À la fin du XVIe siècle, la quasi-totalité du savoir anatomique est constituée. Cette science descriptive et statique entraîne chez les anatomistes un besoin nouveau, celui de comprendre le fonctionnement des organes. Les corps des suppliciés livrés aux anatomistes sont souvent des corps sains ; aussi, peu à peu, l’idée de « vérifier » anatomiquement le corps des malades décédés s’impose.
Les troubles psychiatriques ne sont plus considérés comme une possession démoniaque (condamnés au bûcher).
La chirurgie bénéficie des progrès de l’anatomie ; quelques barbiers réussissent à acquérir le titre de chirurgien. En 1544, François Ier donne aux chirurgiens les mêmes grades universitaires que ceux des médecins. Cependant, ils doivent attendre 1724 pour qu’une chaire de professeur universitaire en chirurgie soit créée.
De grandes épidémies font leur apparition ; il en est ainsi de la syphilis, de la variole, de la rougeole, du typhus. La peste continue de sévir régulièrement.
Les premières armes à feu portatives apparaissent, provoquant des plaies d’un type nouveau.
 Médecins
Médecins
– Jacobus Sylvius (1478–1555) étudie l’anatomie et le fonctionnement du cerveau et laisse son nom à l’aqueduc de Sylvius (entre le tronc cérébral et les hémisphères), la scissure de Sylvius (entre les lobes temporal et frontal) ainsi qu’à l’artère sylvienne.
– Michel Servet (1511–1553), dans un ouvrage de 700 pages, en consacre 6 à la description de la circulation du sang du ventricule droit aux poumons puis des poumons au ventricule gauche. Il décrit le phénomène de l’hématose. Malheureusement, il épouse la cause de l’église réformée ; ses écrits et lui-même sont brûlés.
– Ambroise Paré (1510 ? –1590), ancien barbier devenu médecin de quatre rois de France, est protégé par ces derniers, ce qui lui permet de remettre en cause la pratique de la médecine. Il écrit : « Ce n’est pas grand-chose de feuilleter des traités et de caqueter en chaire si la main ne besogne. » Né à Laval, il s’initie à la médecine chez un chirurgien de Vitré. Arrivé à Paris, il devient aide-chirurgien barbier à l’Hôtel-Dieu puis maître chirurgien. En 1537, il pratique sur un champ de bataille la première désarticulation du coude. Manquant d’huile bouillante que l’on répandait habituellement sur les plaies, il utilise un mélange de jaune d’œuf, d’huile de rosat et de térébenthine. Le patient guérit. À partir de ce fait, il développe l’art du pansement. Il exerce tantôt comme chirurgien à Paris, tantôt sur des champs de bataille. Il obtient du roi François Ier le privilège de publier un ouvrage à partir de ses expériences dans l’art de traiter les plaies contondantes ou par armes à feu. Cet ouvrage soulève l’indignation de la faculté de médecine de Paris car son auteur ne connaît ni Galien, ni le grec, ni le latin. Sa fréquentation des rois de France le protège et il n’est pas poursuivi pour hérésie. Il pratique la première amputation du membre inférieur en ligaturant les artères du blessé qui a survécu (la cautérisation était pratiquée par application de fer rouge, ce qui entraînait souvent la mort par hémorragie). Sur pression du roi Henri II, il est reconnu docteur en chirurgie par la faculté. Il imagine des prothèses pour soulager les mutilés. Il est considéré comme le père de la chirurgie moderne.
– Vésale (1514–1564), né à Bruxelles, étudie la médecine à Paris. Sa passion pour l’anatomie l’entraîne à déterrer des cadavres et dérober des pendus au gibet. Il est nommé professeur à l’université de Padoue. Il est le plus célèbre anatomiste de la Renaissance. Il corrige les erreurs de Galien. Il publie des ouvrages d’anatomie qui sont de véritables chefs-d’œuvre artistiques. Épuisé par les conflits liés à ses découvertes, il abandonne l’enseignement et devient le médecin de Charles Quint qu’il suit dans ses voyages. Il est le père de l’anatomie macroscopique.
– Gabriel Fallope (vers 1523–1562) est le successeur de Vésale. Il élucide la structure de l’oreille interne, étudie l’anatomie de l’appareil génital féminin et laisse son nom aux trompes de Fallope.
– Paracelse (1493–1541), professeur à Bâle, s’oriente vers une conception chimique de la maladie (un désordre métabolique) et développe sa thérapeutique à partir de l’usage du sel, du soufre et du mercure. Chirurgien novateur, il applique des huiles essentielles, du cuivre et de l’argent sur les plaies pour les maintenir propres. Il préconise l’extension de la contention des fractures à l’aide de cercles de fer maintenus séparés par des tiges. Il découvre les bienfaits du mercure sur la syphilis.
– Léonard de Vinci (1452–1519) étudie l’anatomie de façon statique et dynamique (fonctionnement, rapports entre les structures). Il dissèque des cadavres d’hommes, de femmes et de fœtus en vue de réaliser un traité qu’il n’a pas pu achever. Ne se laissant pas influencer par Galien, il identifie les structures du corps aux différents âges de la vie. Il observe et effectue des coupes d’organes associées à des injections dans les vaisseaux et les viscères. Il dissèque l’œil et associe son talent de mathématicien et de géomètre pour émettre des hypothèses sur le mécanisme de la vision. De son traité de 120 livres, il reste 200 cahiers manuscrits et 1500 dessins dont seuls quelques membres de son entourage ont eu connaissance. Son œuvre non publiée est conservée à partir du XVIIe siècle à la bibliothèque du château de Windsor. Consultée par quelques privilégiés, elle est enfin éditée au début du XXe siècle. Son œuvre ne contribue pas au développement de l’anatomie car elle n’est mise en évidence qu’à la découverte de ses croquis en 1784.
– Nostradamus (1503–1566), professeur de médecine à Montpellier, doit abandonner l’enseignement car ses pratiques sont non conformes aux pratiques médicales de son époque (refus des saignées, etc.).
– Rabelais (1483–1553), médecin formé à Montpellier, exerce à Lyon et à Paris. On lui doit de nombreux écrits littéraires.
Les progrès qui touchent les autres domaines de la médecine doivent leur émergence à quelques esprits éclairés qui osent remettre en question les savoirs traditionnels et ouvrir l’accès à la physiologie.
Les chefs de file sont notamment Ambroise Paré (1509–1590), Ibn an-Nafis (1210–1288), dont les travaux sont précurseurs de la découverte de la circulation sanguine par Michel Servet (1509–1553).
 XVIIe siècle
XVIIe siècle
 Rappel historique
Rappel historique
Cette période est marquée par une Église encore très puissante et menaçante à l’égard de certains découvreurs. Galilée reprend les travaux de Copernic, ce qui lui vaut d’être jugé en 1633 comme hérétique. Ce procès marque la suprématie de la théologie sur la science. Pourtant, le XVIIe siècle correspond à une période de révolution scientifique, de développement de la physique, de la chimie, de l’astronomie, des mathématiques, de l’anatomie et de la physiologie. C’est aussi une époque marquée par une révolution philosophique.
– René Descartes (1596–1650) écrit Le Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences et pose les principes de la méthodologie des sciences.
– Galilée (1564–1642), grâce à sa lunette astronomique, observe les planètes et a l’idée d’appliquer son procédé à l’observation des insectes. C’est ainsi que la loupe et le microscope font leur apparition en 1625. Les progrès de l’optique permettent de découvrir un monde inconnu et de chercher à en comprendre son fonctionnement.
En 1665, on emploie pour la première fois le terme de cellule.
 Médecine
Médecine
Marcello Malpighi observe les tissus animaux et fonde l’histologie. Il publie régulièrement ses découvertes concernant l’être humain : les alvéoles pulmonaires, les acini glandulaires, les ganglions lymphatiques, les capillaires, les hématies.
Depuis l’Antiquité, on sait que tout animal provient de l’accouplement d’un mâle et d’une femelle. William Harvey, en disséquant une biche gravide, trouve dans son utérus une poche ovoïde. Il en conclut que les mammifères comme les autres animaux font des œufs. Il pense que l’embryon est le mélange des semences de la femme et de l’homme, formant une matière indifférenciée dans laquelle naîtront tous les organes. Certains diront même avoir identifié dans le spermatozoïde le corps du fœtus.
Reinier De Graff décrit les follicules préovulatoires qu’il suppose être des œufs et il donne le nom d’ovaire aux glandes sexuelles. L’observation du développement d’un poulet dans un œuf fonde les premières théories en embryologie : l’embryon y préexiste-il ? Se forme-t-il progressivement ?
L’art de l’accouchement va s’intégrer peu à peu dans les champs de la médecine. Cependant, l’accouchement reste une affaire de femmes, même en cas d’embryotomie. Amboise Paré, le père des chirurgiens accoucheurs, pratique des manœuvres facilitant l’expulsion et utilisant des spéculums. La césarienne n’est pratiquée que sur des femmes mortes pour extraire le fœtus et surtout le baptiser. La première césarienne avait été pratiquée en 1500 chez une femme dont le travail s’éternisait. Son mari, châtreur de porcs, s’était emparé d’un couteau, avait incisé le ventre de sa femme, extrait l’enfant et pratiqué les sutures (la femme aurait survécu et aurait eu d’autres enfants).
Le fonctionnement de l’organisme est mieux compris, qu’il s’agisse de la respiration, de la circulation sanguine et lymphatique ou de la bile. La théorie des humeurs est discréditée.
En 1684, on connaît 108 sortes de parasites (ascaris, douves, poux, acares, etc.). La thérapeutique s’enrichit de la découverte de l’ipéca, du quinquina et d’autres dérivés de plantes exotiques. Le thé, le café et le cacao, introduits en Europe, sont utilisés comme des thérapeutiques.
Malgré la naissance des premiers journaux médicaux, tous les médecins n’ont pas accès aux découvertes médicales.
 Médecins
Médecins
– William Harvey (1578–1657) décrit la circulation sanguine et le rôle moteur du cœur. Il n’apporte pas d’éléments novateurs, mais tire des conclusions à partir des données connues et de ses observations. Il n’explique pas encore comment le sang passe des artères aux veines et les capillaires ne sont pas encore identifiés. Seul Louis XIV le soutient pour faire accepter sa théorie.
– Marcello Malpighi (1628–1694) décrit notamment les capillaires pulmonaires. Il est le père de l’anatomie microscopique ou histologie.
– Reinier De Graff (1641–1673) décrit l’ovulation, et le spermatozoïde est découvert en 1677.
– Louise Bourgeois (1563–1636), épouse d’un chirurgien barbier élève d’Ambroise Paré, devient sage-femme. Influencée par ce dernier, elle devient la sage-femme de Marie de Médicis et met au monde Louis XIII. En 1626, elle publie un recueil de conseils professionnels avec l’ébauche d’une éthique. L’ouvrage a pour titre Instruction à ma fille. Malheureusement, la mort de Mlle de Montpensier en suite de couches lui vaut les foudres des médecins. Comme Angélique Coudray, elle diffuse des connaissances acquises par l’observation. Ces femmes, comme leurs savoirs empiriques, ne sont pas reconnues et, progressivement, ce sont les médecins qui pratiquent les accouchements. Ils s’approprient leurs connaissances et, à partir de 1627, l’obstétrique devient une science médicale. Louis XIV impose un médecin pour accoucher Madame de La Vallière en 1663.
 Hôpitaux
Hôpitaux
L’hôpital de la Pitié est créé en 1612, celui de la Salpêtrière en 1634, comme refuge pour les mendiants, les infirmes, les enfants abandonnés, les vieillards, les « folles » et les filles de mauvaise vie. N’ayant pas une mission de soins, ces hôpitaux généraux dits du « grand enfermement » sont créés par un édit de Louis XIV en 1662. À la Salpêtrière s’ajoute une maison de détention pour 300 condamnés appelée « La Force ». Ces établissements deviennent en 1801 des hospices civils puis des hospices de la vieillesse. La Salpêtrière accueille les femmes et la Pitié les hommes. On y trouve aussi des personnes âgées et des « insensées », soit un total de 4422 lits.
L’abandon d’enfant est un fléau social qui s’aggrave au XVIIIe siècle du fait de la misère et de la liberté des mœurs : 7000 enfants sont abandonnés tous les ans à Paris. Les enfants sont délaissés aux portes des églises et sont souvent retrouvés morts. Les hôpitaux décident d’installer des « Tours d’abandon » qui permettent le dépôt anonyme de l’enfant et sa prise en charge immédiate ; ils persistent jusqu’en 1860. Dès 1863, les bureaux d’admission sont créés pour accueillir anonymement les mères, leur apporter des aides matérielles et tenter d’éviter l’abandon. Saint Vincent de Paul, alerté par ce problème, met en place des structures d’accueil spécifiques, organise et contrôle l’exercice des nourrices. L’Assistance Publique reprend cette œuvre et crée l’hospice des enfants trouvés qui devient l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1942.
 XVIIIe siècle
XVIIIe siècle
 Rappel historique
Rappel historique
Le XVIIIe siècle, marqué par l’émergence des idées humanitaires et un rejet de l’Église, se caractérise par la naissance d’idées philosophiques novatrices. On cherche à tout expliquer par des lois de mathématiques et de mécanique, on classe les animaux et les plantes. La révolution atteint de plein fouet les revenus et les personnels des hôpitaux, engendrant une situation très grave.
 Médecine
Médecine
Cette période est marquée par un véritable engouement pour la connaissance des êtres humains, des animaux et des végétaux, ce qui explique que de nombreuses écoles sont créées. À la fin de ce siècle, toutes les grandes fonctions physiologiques sont explicitées.
Buffon (1707–1788) publie un traité en 1749 dans lequel il identifie l’origine de la Terre à 4000 ans. Il affirme que les fossiles représentent des formes de vies éteintes et, grâce à lui, on découvre que les premiers hommes ne sont pas les Égyptiens ou les Romains.
Xavier Bichat (1771–1802) ouvre le champ de l’étude de l’histologie grâce à l’amélioration du microscope, aux techniques de coloration et au microtome (appareil qui permet le découpage de fines lamelles de tissus).
L’Italien Jean-Baptiste Morgagni (1682–1771), à Padoue, développe l’étude des tissus lésés recueillis sur des cadavres en faisant le lien avec les symptômes présentés. Il est le père de l’anatomopathologie.
L’exercice de la chirurgie s’organise avec la création de l’Académie royale de chirurgie (1731). Celle-ci est créée pour faire front à l’interdiction faite aux barbiers de pratiquer la chirurgie (1743). Elle siège dans un amphithéâtre, rue des Cordeliers à Paris (1774), qui est toujours le siège actuel d’une faculté de médecine. L’absence de méthode d’anesthésie demande aux chirurgiens une dextérité et une rapidité exceptionnelles. De ce fait, les actes opératoires sont limités. En raison du risque infectieux et de l’absence d’anesthésie, aucune intervention ne peut être pratiquée au niveau du thorax et de l’abdomen.
Les anatomistes de tous les pays complètent les connaissances occidentales sur la structure du corps normal. Morgagni révèle l’intérêt de l’étude des lésions chez l’homme malade et de leur confrontation avec les manifestations cliniques. De plus, la médecine possède désormais un mode de raisonnement et un moyen général de diagnostic : l’histologie.
La tendance dominante est d’imaginer, de mettre en œuvre, puis de développer des moyens objectifs d’examen et d’en confronter les résultats avec les constatations anatomiques correspondantes pour définir et classer les différentes maladies. C’est ainsi que le grand clinicien français Théophile-Hyacinthe Laennec (1781–1826) découvre l’auscultation. Par la suite, les procédés d’investigation clinique ne cessent de se multiplier, notamment en cardiologie et en neurologie.
Très rapidement, l’extension des connaissances médicales aboutit aux spécialisations. Certaines disciplines comme la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie ou la psychiatrie continuent leur développement. D’autres apparaissent vers le milieu ou la fin du XIXe siècle ; il en est ainsi de la neurologie, de la rhumatologie, de l’hématologie, de la cancérologie, de l’allergo-immunologie et de l’endocrinologie
En santé publique, des innovations importantes voient le jour. C’est le cas de l’aération des logis, de la reconnaissance des bienfaits de l’exercice physique, de la nécessité d’une bonne hygiène alimentaire, de la prévention du scorbut grâce au jus de citron et d’orange pour les marins. Sur le plan administratif, la tenue de registres des naissances, des décès, des maladies, des épidémies est mise en place. Un réseau national de correspondants chargés d’observer l’apparition d’épidémies, l’état de nutrition des populations, de leur habitat et de leur hygiène de vie est instauré.
Les thérapeutiques évoluent peu et la mode consiste à proposer des remèdes miraculeux comme « la jouvence de l’abbé Soury » dont la recette est établie en 1764.
En 1791, la première fécondation d’une femme par insémination artificielle aboutit à la naissance d’un enfant ; elle est ignorée du monde médical.
La Révolution française modifie l’exercice de la médecine.
La Société de médecine et l’Académie de chirurgie, au même titre que toutes les sociétés ou académies littéraires ou scientifiques, disparaissent en 1793. C’est en 1794 que la formation des médecins et des chirurgiens s’organise grâce à la fondation de trois écoles de santé. Au programme des cours apparaissent la médecine légale, l’histoire de la médecine, la physique et la chimie. La formation implique obligatoirement des stages hospitaliers. Ces écoles forment des officiers de santé qui obtiennent un droit d’exercice temporaire après la Révolution lorsque la formation devient du niveau doctorat. En 1802, une nouvelle organisation des études instaure l’internat, ce qui se traduit par la présence permanente des médecins dans les hôpitaux.
 Médecins
Médecins
L’étude du corps humain se fait à partir d’expériences. Les médecins abandonnent le concept de la maladie comme désordre général du corps et admettent la notion de lésion locale, ce qui entraîne la spécialisation des savoirs médicaux dont la première est la cardiologie. L’explication du mécanisme de la respiration est mieux comprise grâce à Antoine Laurent Lavoisier qui détermine en 1777 la composition de l’air et explique le mécanisme de la respiration et de la transpiration.
Les cliniciens et thérapeutes de cette époque ne sont pas à l’origine de progrès décisifs ; cependant, ils font progresser la nosologie et les conditions d’hygiène.
– René-Antoine de Réaumur (1683–1757) détermine la composition du suc gastrique et son mode d’action.
– Lazzaro Spallanzani (1729–1799), expérimentateur ingénieux, réalise en 1777 la première expérience de fécondation in vitro en arrosant des œufs de crapaud femelle par le sperme d’un mâle. Il réalise ensuite avec succès une fécondation chez une chienne. Il étudie la digestion en faisant avaler des éponges à des dindons. Il est le premier à cultiver des microbes sur du jus de viande (non bouilli, à l’air ambiant). Il met en évidence que les microbes se multiplient en se divisant par deux.
– Jean-Louis Petit (1674–1750), chirurgien très novateur, réalise les premières paracentèses et la première trépanation de la mastoïde. Il met en évidence l’hémostase et invente le garrot en 1744.
– Jean-Louis Baudelocque (1745–1810), médecin à la maternité de Port-Royal, crée la chaire d’obstétrique à la faculté de médecine de Paris et fonde en 1802 l’école de sages-femmes (la première école de sages-femmes existe depuis 1728 à Strasbourg au sein de l’école de médecine).
– Philippe Pinel (1745–1826), pionner de la psychiatrie moderne, est nommé médecin chef à Bicêtre en 1793, puis à la Salpêtrière. Il fait libérer les aliénés de leurs chaînes et insiste sur le rôle de l’hygiène, de l’alimentation et sur la nécessité d’instaurer un climat de confiance avec les patients. Il est à l’origine de la reconnaissance de l’autorité du médecin psychiatre dans les asiles au détriment de celle détenue par le lieutenant de police. Ce clinicien réalise une classification des maladies mentales à partir de ses observations et fait ainsi progresser la nosologie psychiatrique.

Figure 1.6 Pinel fait enlever les fers aux aliénés de Bicêtre
Charles Louis Muller. Peinture – Huile sur toile. XIXe siècle. © Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine.
– Edward Jenner (1749–1823) est à l’origine des progrès majeurs de cette période : il invente le vaccin contre la variole. Constatant que les fermières qui assuraient la traite de vaches atteintes de la vaccine étaient protégées de la variole, il inocule en 1796 à un jeune paysan le contenu d’une pustule de fermière ayant la vaccine. Contesté par ses pairs parce qu’il pratique la méthode d’inoculation, considérée comme dangereuse, à partir d’une pustule variolique, Jenner l’applique en Orient, en Asie et aux Antilles. Sa méthode est adoptée en France avec obligation vaccinale en 1902.
– Joseph Ignace Guillotin (1738–1814), enseignant à la faculté de médecine de Paris, député, est partisan de la guillotine par souci d’humanité pour que le châtiment soit le même pour tous et le moins douloureux possible. Emprisonné pendant la Terreur, il se retire de la vie politique et refuse que l’on prononce devant lui le nom de l’instrument auquel il a donné son nom.
 Hôpitaux
Hôpitaux
On distingue les petits hôpitaux locaux assurant des soins variés, les Hôtels-Dieu assurant l’accueil et les soins médicaux, les hôpitaux généraux recevant les laissés pour compte de la société. Les structures hospitalières sont remises en cause et certaines personnes disent que « ces établissements augmentent le nombre de pauvres par la certitude de secours et séparent les malades du soutien de leur famille alors qu’ils seraient mieux traités au sein des leurs ».
 Époque contemporaine6
Époque contemporaine6
 XIXe siècle
XIXe siècle
 Rappel historique
Rappel historique
Le XIXe siècle est une période d’instabilité politique où se succèdent le Consulat, le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de 1830, la Révolution de 1848, la République et le Second Empire. Cette période se caractérise par le retour en force de l’Église, l’expansion coloniale et la révolution industrielle, avec une accélération des progrès techniques. De nombreuses inventions révolutionnent les modes de vie : le chemin de fer, les bateaux à vapeur, le percement du canal de Suez, la photographie, le téléphone, la lampe à incandescence et le cinéma.
– Charles Darwin élabore sa théorie de l’évolution.
– Gregor Mendel élabore sa théorie de l’hérédité – les lois sur l’hérédité sont consignées dans un travail de statistiques resté confidentiel (1865).
– Henri Dunant préconise le recrutement de volontaires préparés aux activités de secours aux blessés. Il établit une convention qui accorde aux hôpitaux le statut de territoire neutre. Il participe à la fondation en 1864 du Comité International de la Croix-Rouge à Genève.
– En 1893, l’assistance médicale gratuite est instaurée pour les indigents et la notion d’assurance contre la maladie commence à se développer en 1894 au sein des sociétés minières, suivies en 1909 par les sociétés ferroviaires.
 Médecine
Médecine
La maladie est reconnue comme un trouble du milieu intérieur précédant les lésions tissulaires ou cellulaires. L’examen clinique du malade devient fondamental grâce à la percussion préconisée par Jean Nicolas Corvisart et à l’auscultation avec un stéthoscope recommandée par Laennec. L’examen clinique s’enrichit d’explorations chimiques et d’appareillages nouveaux permettant la mesure du pouls, de la pression artérielle et de la température.
En 1868, on met en évidence que la cellule précurseur des globules sanguins est située dans la moelle osseuse.
Magendie considère que l’explication des mécanismes du vivant ne peut être séparée de la physique et de la chimie. Il étudie le métabolisme et la nutrition et crée la biologie (1830). Le dosage chimique des substances constituant les liquides humoraux s’enrichit d’un nouveau mode d’exploration : la biopsie.
Theodor Schwann définit la cellule (1838) ; Paul Langerhans décrit les îlots du pancréas (1869) ; Xavier Bichat distingue au sein des organes les différents tissus et créé l’histologie ; Claude Bernard crée la physiologie expérimentale ; Ivan Pavlov découvre les réflexes conditionnés (1879) ; Semmelweis met en évidence dès 1846 la contamination manuportée chez les femmes accouchées. Dans le service de maternité de l’hôpital de Vienne, il obtient une chute de la mortalité de 27 % à 0,23 % en préconisant le lavage des mains.
De nombreux agents infectieux sont identifiés :
– le bacille de la lèpre (1873) par Gerhard Hansen ;
– le bacille de la typhoïde (1879) par Carol Eberth ;
– le gonocoque (1879) par Neisser ;
– l’hématozoaire du paludisme (1881) par Alphonse Laverand ;
– les bacilles de la diphtérie, du tétanos, du choléra (1884) ;
Les micro-organismes responsables des maladies infectieuses sont isolés à partir des travaux de Joseph Pasteur et de Robert Koch.
La coloration de Gram (1884) est mise au point par le Danois Hans Christian Gram ; il s’agit d’une technique de coloration qui permet de différencier les bactéries. Tous les germes des maladies infectieuses sont identifiés dans les 20 dernières années du siècle.
Au début du siècle, les chirurgiens sont très adroits et de grande valeur, mais ils opèrent peu car ils doivent faire face à de nombreux échecs. Les trois ennemis historiques de la chirurgie sont l’hémorragie, la douleur et l’infection. Les patients sont opérés dans la salle commune de l’hôpital. La douleur est soulagée par des préparations opiacées (à faible dose), des enveloppements froids ou du vin chaud. Le plus souvent, le malade fait une syncope salvatrice pendant laquelle l’opérateur doit agir vite.
À la fin du siècle, la chirurgie est en plein essor grâce à :
– l’abolition de la douleur avec l’apparition de l’anesthésie qui est pratiquée avec de l’éther à partir de 1846, puis avec du chloroforme en 1847 (permettant des interventions d’une durée inférieure à 60 minutes) ;
– l’utilisation de l’anesthésie locale en 1884 par instillation oculaire de cocaïne qui est progressivement utilisée par voie sous-cutanée ;
– la prévention de l’infection grâce aux travaux de Joseph Lister qui met en évidence l’intérêt du phénol en 1867 (l’antisepsie), les méthodes d’asepsie (1886) par chaleur sèche (étuve ou flambage) ou humide (autoclave), l’usage de gants de caoutchouc stérilisés et le port de blouses, de calots à partir de la fin du siècle ;
– l’évolution des instruments chirurgicaux comme la mise au point de pinces hémostatiques par Jules Émile Péan et Emil Theodor Kocher, l’aiguille de suture de Jacques Reverdin et les écarteurs de Louis Farabœuf ;
Ces évolutions sont à l’origine de l’exploration chirurgicale de la cavité abdominale, du tube digestif et des poumons. Les premières grandes interventions réalisées portent sur le sein pour tumorectomie (1880) et pour mastectomie par William Halstead (1895), le cerveau pour exérèse tumorale (1881), la vésicule biliaire pour exérèse (1882), l’appendice (appendicectomie réussie en 1883), la moelle pour tumeur (1887), le rein pour tumeur (1889), l’estomac (gastrectomie totale en 1890), l’œsophage (œsophagectomie en 1892), le côlon (résection en 1895).
Ce siècle est marqué par de grands progrès, mais aussi par les nombreuses épidémies qui sévissent au sein de la population. Parmi les plus importantes, notons la tuberculose, la diphtérie, la peste et le typhus.
Philippe Pinel et Jean Esquirol ayant obtenu en 1794 le retrait des chaînes aux aliénés, une nouvelle spécialité apparaît, la psychiatrie. Esquirol décrit les différentes formes de folies dans un traité et crée une maison d’aliénés modèle. Ces progrès sont à l’origine de la mise en place des asiles d’aliénés, de la loi de 1838 qui instaure les règles de fonctionnement de ces établissements et les procédures d’hospitalisation, ainsi que l’établissement d’entités cliniques.
C’est aussi le début de la santé publique, marqué par la mise au point d’études statistiques à partir des naissances et des décès ; la création des Conseils d’hygiène dans les grandes villes (à Paris à partir de 1802) qui évaluent la salubrité des usines et des ateliers ; l’organisation des cimetières, des décharges, des abattoirs et des bains publics ; le développement de réseaux d’égouts ; la lutte contre les logements insalubres ; l’instauration dans les écoles de cours d’hygiène obligatoires, l’instituteur étant habilité à faire une « visite de propreté ».
C’est enfin l’essor des innovations. Les principales portent sur la pharmacologie et sur les procédés d’examen dont certains permettent les mesures des paramètres biologiques.
L’objectif de la pharmacie est de découvrir et d’extraire les principes actifs des plantes ou des tissus. Les formes galéniques évoluent, la capsule est créée en 1834, le comprimé en 1843, l’injection sous-cutanée en 1845.
Les principales innovations pratiques de la médecine moderne portent sur les moyens de traitements. Les progrès sont favorisés par la mise au point de procédés d’extraction et de dosage des principes actifs. Simultanément, la pharmacologie expérimentale, fondée par F. Magendie, donne une base scientifique à l’étude des médicaments et de leurs effets. Le recours à de nouveaux modes d’administration (comprimés [1843], injections parentérales [à partir de 1850]) permet de régulariser et de renforcer leur action. Depuis 1880, l’industrie pharmaceutique est devenue à la fois le stimulant et le bénéficiaire de la recherche médicale.
Grâce à l’effort conjugué des pharmacologues, des chimistes et des cliniciens, d’innombrables médicaments sont découverts dans le courant des 150 dernières années et principalement depuis la fin des deux dernières guerres mondiales.
Parallèlement, la chirurgie accomplit aussi de remarquables progrès, suite à la prise en charge de la douleur, et grâce au développement de l’anesthésiologie. Depuis 1842, cette discipline est devenue une spécialité autonome qui fait appel à des notions physiologiques et biochimiques précises.
Cette spécialité autonome fait appel à des notions physiologiques et biochimiques précises, et utilise des agents pharmacodynamiques puissants ainsi que des procédés de rééquilibration et de réanimation. Elle a fortement diminué les risques liés au « choc opératoire », permettant ainsi un haut degré de maîtrise chirurgicale. Les opérations d’exérèse (amputations, ablation d’un organe malade) ont précédé les interventions réparatrices (chirurgie orthopédique, plastique) ou fonctionnelles (chirurgie de réduction, de dérivation ou de section physiologique, par exemple).
Une préoccupation majeure reste le mécanisme des maladies, bien que celui-ci se soit progressivement éclairci à la lumière de la physiopathologie. Un des pionniers de cette discipline est Claude Bernard, qui crée et codifie la biophysique et la biochimie. Il démontre aussi que les troubles cliniques sont moins liés aux lésions anatomiques qu’aux troubles des fonctions et de l’homéostasie. Ces avancées guident le développement de la recherche biologique et bactériologique avec :
– les dosages chimiques du sang et de tous les constituants minéraux ou organiques des humeurs ;
– les dosages bactériologiques recherchant et identifiant les différents germes pathogènes dans les liquides naturels ou pathologiques, les sécrétions et épanchements, le sang, le liquide céphalorachidien prélevé par ponction lombaire (H. Quincke, 1891) ;
– la recherche des anticorps qui est à l’origine de la méthode du sérodiagnostic imaginée par F. Widal en 1896, celle de la déviation du complément (A. Von Wassermann, 1906), ou encore celle des tests d’allergie cutanée (C. Von Pirquet, 1907 ; C. Mantoux, 1908).
Les examens biologiques complètent ainsi les données de la clinique.
L’enseignement est rénové et uniformisé. Son évolution est marquée par :
– l’abandon des matières théoriques abstraites ;
– la formation pratique obligatoire au lit du malade dans les hôpitaux et lors d’autopsies ;
– le remplacement du latin par le français ;
– l’enseignement commun aux médecins et aux chirurgiens d’une durée de 4 ans ;
– l’obligation d’avoir le doctorat pour exercer et la création de l’internat de médecine à Paris en 1802.
 Médecins
Médecins
– Louis Pasteur (1822–1895), chimiste à l’origine, est devenu célèbre par ses travaux sur la fermentation, le vin, la bière, le vinaigre et les maladies du vers à soie, ce qui l’oriente vers la microbiologie. Son œuvre scientifique porte sur :
– l’étude et le rôle des « microbes » qu’il identifie en 1878 (staphylocoque, streptocoque) – il met fin à la théorie de l’hétérogénie (génération spontanée) ;
– l’asepsie et l’antisepsie (lavage des mains, flambage des instrument, passage au four des matériaux de pansements, usage d’eau bouillie) ;
– la vaccination (le vieillissement de culture microbienne entraîne l’atténuation de sa virulence).
– Robert Koch (1843–1910), médecin, considéré avec Pasteur comme le père de la microbiologie, met au point des techniques telles que les milieux nutritifs de culture de bactéries, les colorations spécifiques, l’isolement de germe spécifique. Il isole le bacille tuberculeux et le met en culture en 1882. Il identifie le vibrion du choléra en 1883.
– Alexandre Yersin (1863–1943), ancien médecin de l’Institut Pasteur, travaille en Extrême-Orient dans les messageries maritimes au moment où une épidémie de peste se déclare à Hong Kong. Il veut devancer les travaux d’une expédition japonaise déjà sur place. Il obtient de façon clandestine un cadavre infecté et identifie le bacille responsable de la peste. Il constate la présence de bubons chez les rats et y découvre aussi la bactérie. Cependant, il ne découvre pas le rôle de la puce dans la transmission de la maladie de rat à rat et de rat à l’homme.
– Jean-Martin Charcot (1825–1893), chef de service à la Salpêtrière, est le fondateur de la neurologie française. Il étudie toutes les maladies du système nerveux, de la sclérose en plaques aux localisations cérébrales de certaines pathologies. Il s’est aussi intéressé à la maladie psychiatrique et surtout à l’hystérie. Professeur à la faculté de médecine de Paris, il crée en 1881 la chaire de neurologie.
– Claude Bernard (1813–1878) est le père de la recherche médicale en introduisant la méthode expérimentale. Il étudie les sécrétions digestives, le rôle du pancréas, la fonction glycogénique du foie, le glycogène et le rôle du système nerveux dans la régulation de la glycémie. Il réalise le premier cathétérisme cardiaque chez des chiens et des chevaux. En 1865, il publie Introduction à l’étude de la médecine expérimentale.
– François Broussais (1772–1838), chirurgien dans la marine, suit les campagnes militaires de Napoléon. Professeur au Val-de-Grâce et à la Sorbonne, il définit la maladie comme étant due à une irritation gastro-intestinale et défend (à tort) la pratique de la saignée, ce qui est à l’origine de la phrase célèbre en son temps : « Napoléon décima la France, Broussais la saigna à blanc ».
– René-Marie-Hyacinthe Laennec (1781–1826) est essentiellement un clinicien. Il a été chirurgien dans l’armée, médecin hospitalier, professeur au Collège de France. En 1816, il met au point le stéthoscope et publie en 1819 un ouvrage reliant l’auscultation aux pathologies respiratoires et cardiaques. Il donne des noms (par exemple râles sibilants) aux signes rencontrés. Il meurt à 45 ans de tuberculose.
– Emil Theodor Kocher (1841–1917), chirurgien, reçoit le prix Nobel de médecine en 1909 pour son travail concernant la chirurgie thyroïdienne.
– Alexis Carrel (1873–1941), chirurgien, reçoit le prix Nobel de médecine en 1912 pour ses travaux sur les sutures vasculaires.
– Émile Littré (1801–1881) fait ses études de médecine à Paris. Il passe l’internat et ne peut obtenir son doctorat car le décès de son père le laisse avec des dettes. Il fonde deux revues médicales et traduit l’œuvre complète d’Hippocrate. Son œuvre majeure est la rédaction à partir de 1863 d’un Dictionnaire de la langue française connu depuis sous le nom de Littré.
C’est Pierre-Fidèle Bretonneau (1778–1862) qui révèle une spécificité étiologique aux maladies, contrairement à l’opinion de François Broussais qui les rapportait toutes indistinctement à une irritation gastro-intestinale. La confirmation fut apportée, vers la fin du XIXe siècle, par les travaux des deux fondateurs de la microbiologie, Louis Pasteur en France et Robert Koch en Allemagne.
L’œuvre de ces médecins, complétée à une cadence accélérée par plusieurs de leurs élèves, aboutit à l’identification de très nombreux agents pathogènes – bactéries, spirochètes, parasites unicellulaires, virus filtrants, etc. Les conséquences théoriques et pratiques en sont incalculables dans le domaine du diagnostic, de l’épidémiologie, de la prémunition par les vaccins ou de la thérapeutique par les sérums. La bactériologie inaugure l’ère de l’asepsie et ouvre le domaine de l’immunologie qui donne à la recherche médicale contemporaine une de ses orientations dominantes.
 Hôpitaux
Hôpitaux
Le Concordat reconnaît les ordres hospitaliers en 1801. Le Directoire restitue leurs biens aux hôpitaux qui sont placés sous l’autorité du maire ou du préfet et il fait appel aux ordres religieux pour assurer les soins. Les religieuses sont sous la responsabilité de l’administration hospitalière.
Le droit hospitalier fondé par le Directoire et le Consulat dure jusqu’en 1940. La fonction administrative d’organisation et de gestion est confiée à des laïcs. L’Assistance Publique est créée en 1849 pour mettre en œuvre une politique sociale et sanitaire envers les indigents. Dans les hôpitaux, au nom de la morale et de la contagion, on impose le lit individuel dans des chambres communes ; des WC modernes, des douches et des bains de propreté voient le jour. On construit des pavillons spécifiques à des pathologies transmissibles. Les salles d’opération sont modernisées avec : autoclave, Poupinel, arrivée d’eau.
 XXe siècle
XXe siècle
 Rappel historique
Rappel historique
Le XXe siècle est marqué par de grands bouleversements géopolitiques à la suite des deux guerres mondiales et par une course aux découvertes dans toutes les disciplines. Cela se traduit notamment par le développement des moyens de transport, des moyens de communication et un essor de la biologie, de la chimie et des sciences physiques.
Des progrès gigantesques modifient le regard des hommes sur le monde et les rapports entre les individus. L’espérance de vie s’allonge de plus de 30 ans. La Première Guerre mondiale inaugure le développement de la transfusion sanguine, de la chirurgie d’urgence, de l’application de l’antisepsie et le transport des blessés. Les sciences physiques, chimiques, biologiques font un bond considérable et leurs avancées sont démultipliées par l’informatique. La médecine n’échappe pas à ces progrès dont elle profite directement. Les médecins intègrent l’introduction de la technologie dans leur pratique et le développement des examens complémentaires favorise une approche sélective des pathologies. L’imagerie médicale rend le corps de l’homme « transparent », avec des explorations indolores et fiables. De nombreuses pathologies infectieuses sont éradiquées, de nouvelles apparaissent.
On ne peut dissocier les progrès de l’anesthésie de l’apparition de la réanimation, notamment grâce aux travaux de Jean Hamburger qui met en évidence que la mort peut résulter d’anomalies chimiques du milieu intérieur.
La lutte pour le maintien de la vie entraîne l’organisation de services d’urgences avec les services mobiles d’urgences et de réanimation (Smur).
Les sciences humaines se développent et évoluent. Elles donnent un autre regard sur l’homme, le monde et les faits sociaux.
Ce siècle connaît des conflits effroyables en regard desquels se développe l’éthique médicale, notamment suite au procès de Nuremberg.
La guerre du Biafra et la famine qu’elle engendre sont à l’origine de la création de la médecine humanitaire.
La mondialisation implique une réflexion croissante sur l’avenir souhaitable et/ou souhaité du développement des sciences et de leurs applications.
 Médecine
Médecine
La médecine est marquée par le développement des connaissances en virologie, en immunologie, en génétique, etc. Dès 1892, un étudiant en botanique de Saint-Pétersbourg découvre le premier virus. Les virus de la fièvre jaune, de la rage et de la poliomyélite sont identifiés en 1902. L’étude des virus repose sur l’examen indirect après passage sur des filtres et par inoculation à des animaux de laboratoire. Ce n’est qu’après 1940 que les premières images de virus sont rendues possibles grâce au microscope électronique. En 1949, la culture cellulaire permet l’étude des virus.
L’immunologie apparaît. Les grandes étapes de son essor sont liées à la découverte de la phagocytose qui est décrite en 1883, à l’anaphylaxie qui est mise en évidence dès 1902, à l’identification du rôle du système immunitaire à partir de 1960 et à de nouvelles thérapeutiques telles que la cortisone7 et les antihistaminiques en 1942. En 1980, Georges Snell, Baruj Benacerraf et Jean Dausset reçoivent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur l’histocompatibilité (système HLA).
La génétique progresse grâce à la mise en évidence des 46 chromosomes humains en 1950, et à la découverte de la structure des acides nucléiques en 1953. En 1966, le code génétique est établi et c’est à partir de 1975 que des techniques de recombinaison génétique in vitro (génétique moléculaire, génie génétique) permettent l’isolement d’un fragment d’ADN d’un chromosome, la possibilité de le modifier et de le réintroduire dans l’organisme. En 1986, on localise les gènes responsables de certaines pathologies. De 1990 à 2001, des scientifiques américains de laboratoires privés et ceux de laboratoires français publics travaillent en concurrence pour établir la carte complète des chromosomes humains.
La cardiologie, première spécialité médicale, conforte son envol. La maîtrise de la physiologie cardiaque et de l’hémodynamique entraîne la fabrication d’appareils de mesure de la pression artérielle au pli du coude (1905) et de l’électrocardiogramme (ECG) (1907).
La radiologie permet la réalisation du cathétérisme cardiaque de façon expérimentale par Werner Forssmann sur lui-même (1929) puis sur des malades (en 1945 pour le cœur droit et en 1952 pour le gauche). Le traitement chirurgical des affections cardiovasculaires prend réellement son essor en 1953 avec la mise au point de la circulation extracorporelle, complétée en 1958 par la pratique de l’hypothermie. Suivent la pose des premiers pacemakers en 1958, celle d’une valve cardiaque artificielle par Isaac Starr en 1960 remplacée par les bioprothèses dès 1965, et le pontage coronarien dès 1967. La première transplantation cardiaque est réalisée en 1967 par Christiaan Barnard (le patient survit 17 jours). Dès 1979, la commercialisation de la ciclosporine (médicament antirejet) relance la pratique des greffes.
Les innovations thérapeutiques sont marquées par l’usage de l’héparine (intraveineuse en 1945, en sous-cutanée en 1966), des antivitamines K (dicoumarol en 1941, Tromexane en 1951 ; Pindione en 1952), des diurétiques mercuriels (toxiques) dès 1920 et surtout du furosémide, le premier diurétique bien toléré en 1965, et les antihypertenseurs (réserpine, hydralazine) en 1945.
En ce qui concerne l’hématologie, la découverte des groupes sanguins du système ABO en 1901 par Karl Landsteiner favorise les transfusions sanguines bras à bras ; l’adjonction de citrate de sodium rend possible la conservation du sang au cours de la Première Guerre mondiale. L’hôpital Saint-Antoine, en 1923, crée le premier centre de transfusion, suivi en 1928 par la création d’un centre national en vue de la recherche de donneurs. En 1940, on découvre le facteur Rhésus. Dès 1950, le risque de transmission d’agents infectieux lors de transfusions est mis en évidence – en 1992 commence le procès du sang contaminé.
Dans le domaine de la cancérologie, la mortalité liée aux cancers est importante et les traitements quasi inexistants au début du siècle. Les premières possibilités thérapeutiques sont l’exérèse mutilante d’organes atteints de tumeur cancéreuse, telles l’œsophagectomie, les gastrectomies, les mammectomies ou l’hystérectomie. On recherche l’origine des tumeurs en mettant en évidence des étiologies chimiques, virologiques ou radio-induites. Dès 1960, on identifie la nocivité de l’alcool et du tabac.
La radiothérapie est développée dès 1904 avec des applications de radium sur des lésions cutanées puis sur des tumeurs malignes ORL et gynécologiques. Dès 1905, les premières utilisations de la radiothérapie externe sur la rate et les ganglions de patients atteints d’hémopathies malignes sont mises en œuvre. Les premiers essais cliniques avec la bombe au cobalt débutent en 1950.
Le premier traitement chimique est découvert par hasard. En 1943, un navire américain coule avec dans ses soutes 100 tonnes de moutarde azotée, produit dérivé du gaz moutarde. Les rescapés, dont la peau et les poumons sont brûlés, présentent une forte diminution des globules blancs. Frederick Philips et Alfred Gilman, informés de ces faits, les étudient et montrent que ce produit inhibe la division cellulaire et a une action toxique sur le noyau des cellules en division. Dès 1944, une femme atteinte d’un lymphome radiorésistant est traitée aux États-Unis. C’est le premier anticancéreux. La chimiothérapie se développe dès 1950. Jean Mathé réalise la première greffe de moelle osseuse en 1957.
L’endocrinologie devient une spécialité médicale en 1912. On découvre l’adrénaline en 1901 ; la thyroxine en 1914. F.G. Banting isole l’insuline en 1921, ce qui lui vaut le prix Nobel en 1923. En 1942, un médecin de Montpellier remarque que les sulfamides utilisés pour traiter une épidémie de typhoïde entraînent une baisse de la glycémie. Des expériences sur le chien confirment cet effet. Il faut attendre 1946 pour que les laboratoires s’intéressent à cette découverte ; deux sulfamides hypoglycémiants sont commercialisés en 1956.
La contraception apparaît. On procède en 1909 au premier essai d’un dispositif intra-utérin métallique dont l’usage doit être abandonné en raison du risque infectieux. Les études reprennent avec mise au point d’un stérilet en plastique en 1959, en cuivre en 1969, avec libération de progestérone en 1975. En 1927, un médecin autrichien, Ludwig Haberlandt, met en évidence que l’administration d’extraits ovariens aux lapines gravides entraîne leur stérilité temporaire. Malheureusement, les pays ruinés par la Première Guerre mondiale sont essentiellement préoccupés par le repeuplement, et ce médecin n’a pas les moyens d’expérimenter son hypothèse sur des femmes.
Kyusaku Ogino crée une méthode de contraception fondée sur la surveillance de la température corporelle en 1930. Dès 1938, les premiers estrogènes artificiels actifs par voie buccale sont utilisés, dont le trop célèbre distilbène. En 1941, un chercheur découvre que des femmes de tribus indiennes du Nevada utilisent des tisanes contraceptives ; à partir de la plante, il extrait la progestérone.
En 1952, Gregory Pincus est convaincu, par deux femmes créatrices du planning familial de New York et une milliardaire qui finance le projet, de faire de la recherche dans ce domaine. En 1959, le traitement est commercialisé comme traitement des troubles menstruels, puis en 1960 comme contraceptif. La commercialisation en France commence en 1967 (loi Neuwirth). À partir de 1970, les pilules sont plus faiblement dosées, minidosées dès 1980. Certaines sont remboursées dès 1974. En 1975, la loi dite Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Elle est remboursée par la Sécurité sociale en 1982, date à laquelle Étienne-Émile Baulieu met au point le RU 486, ou pilule abortive, commercialisé en 1989.
La procréation médicalement assistée se développe pour permettre aux couples stériles de pouvoir devenir parents. Elle débute avec la mise au point de l’insémination artificielle avec donneur anonyme dès 1970, ce qui entraîne la création des premières banques de sperme (1973). En 1978, naît Louise Brown, premier bébé issu de fécondation in vitro, et en 1984 naît Zoé, premier bébé issu d’un embryon congelé. Dès 1990, le diagnostic préimplantatoire peut être réalisé sur des embryons humains.
La psychanalyse naît sous l’impulsion de Sigmund Freud qui publie L’Interprétation des rêves en 1900 et fonde en 1902 la Société psychologique du mercredi qui deviendra la Société psychanalytique de Vienne.
La psychiatrie se développe alors grâce notamment aux découvertes médicamenteuses.
Dès 1932, la cure d’insuline réalise un coma diabétique et améliore l’état des schizophrènes. Les électrochocs sont utilisés à des fins thérapeutiques dès 1938.
Henri-Marie Laborit découvre le premier neuroleptique, la chlorpromazine (Largactil).
La mise au point des premiers antidépresseurs est réalisée en 1957.
L’infectiologie doit essentiellement son développement à la recherche d’une étiologie, à la mise au point de nombreux vaccins et aux nouveaux médicaments particulièrement efficaces, au point de faire oublier parfois les mesures d’hygiène.
Le BCG est mis au point en 1921 par Léon-Charles-Albert Calmette et Jean-Marie Guérin. Ce vaccin devient obligatoire en France en 1950 pour les enfants dès l’âge de 6 ans pour lutter contre la tuberculose.
En 1923, la découverte de l’anatoxine tétanique est suivie d’une recommandation de vacciner les femmes enceintes pour assurer la prévention du tétanos néonatal en 1927.
Suivent de nombreux autres vaccins dont celui contre la coqueluche (1931), contre la fièvre jaune (1932), contre la poliomyélite en 1955 (administré par voie orale dès 1957), contre la rougeole (1958), contre la rubéole et les oreillons (1969) et contre l’hépatite (1976).
En ce qui concerne les nouveaux traitements anti-infectieux, le premier sulfamide est commercialisé en 1935 par le laboratoire Rhône-Poulenc.
Alexander Fleming découvre pour sa part de façon accidentelle en 1929 l’action antibactérienne de la pénicilline. Ne mesurant pas l’importance de sa découverte, il l’utilise comme réactif de laboratoire. En 1941, la première injection expérimentale est pratiquée chez l’homme et les laboratoires Merck, Pfizer et Squibb se lancent dans la production industrielle. Dès 1942, les médecins militaires des unités combattantes d’Afrique du Nord reçoivent le produit. Les résultats sont remarquables.
En 1948, l’auréomycine est découverte ; c’est le premier antibiotique de la classe des tétracyclines.
En 1954, l’érythromycine est commercialisée ; c’est le premier antibiotique macrolide.
Pour ce qui est des traitements antituberculeux, en 1949, un microbiologiste américain travaillant en agronomie, appelé par un fermier qui se plaint de la mort de toutes ses poules, découvre que la moisissure responsable a une activité sur le bacille de Koch. La commercialisation de ce produit miracle, la streptomycine, commence la même année. En 1952, l’isoniazide est mis au point. Associé à la streptomycine, il fait diminuer la mortalité de la tuberculose de 40 % de 1952 à 1954. En 1968, arrive la rifampicine suivie en 1970 du myambutol.
Dès 1970, un médecin du laboratoire Wellcome se lance dans la recherche d’un médicament pour lutter contre l’herpès et découvre l’aciclovir ; c’est le premier antiviral.
La chirurgie, qui reposait sur l’ablation de l’organe malade, devient réparatrice et plastique. Elle est marquée, au cours de la Première Guerre mondiale, par le concept de l’intervention précoce pour limiter la contamination profonde des tissus sous l’instigation des bactériologues. Ces derniers incitent à l’installation de postes de secours avec des structures mobiles composées d’équipes sanitaires, d’automobiles chirurgicales et de campements. Cela permet la mise en place de conduites à tenir devant des blessures (désinfection, ablation des tissus nécrosés et des corps étrangers et rapprochement des chairs dans un délai de 10 heures au plus) et fait prendre conscience de l’intérêt de la stérilisation du matériel (bouilloire, étuve type Poupinel, autoclave).
Durant cette période, se généralisent la technique de l’irrigation des plaies (mise au point par H.D. Dakin), l’injection de sérum antitétanique à tous les blessés et l’emploi de l’anesthésie avec des mélanges gazeux qui favorisera l’essor des techniques d’anesthésie intraveineuse ou locale.
La Seconde Guerre mondiale constitue une période d’évolution. Sous l’impulsion du service de santé de l’armée américaine, on observe l’apparition des MASH (military advanced surgery hospitals) qui sont des hôpitaux situés sur le front, au cours de la guerre de Corée. Ce dispositif est complété par l’utilisation des véhicules blindés sanitaires, des évacuations sanitaires aériennes. De nouvelles techniques sont pratiquées, comme l’intubation orotrachéale, l’utilisation des respirateurs, le remplissage vasculaire des blessés par des solutions synthétiques et du plasma. Le développement de la transfusion, de la réanimation et de l’anesthésie est à l’origine de nouvelles spécialités médicales.
Cette période est aussi marquée par l’essor de la chirurgie correctrice qui obtient des résultats très brillants dans le traitement des malformations cardiaques ou vasculaires.
La tendance la plus récente est la chirurgie de substitution, dite chirurgie des « greffes » (peau, cornée, rein, cœur, etc.) ; néanmoins, elle se heurte encore à des difficultés d’ordre immunologique de mieux en mieux surmontées.
Les greffes concourent à l’évolution des techniques chirurgicales :
– 1906, transplantation d’un rein de porc sur un homme ;
– 1952, première greffe rénale d’une mère à son fils par Jean Hamburger qui aboutit à un rejet au 20e jour ;
– 1957, greffe de moelle osseuse par Jean Mathé ;
– 1963, greffe de foie aux États-Unis ;
– 1967, transplantation cardiaque par Christiaan Barnard et première greffe hépatique ;
Son essor est lié à la commercialisation de la ciclosporine dont l’efficacité relance la pratique des greffes d’organes en 1979.
Dans le même temps se développe l’utilisation de prothèses articulaires dès 1960, du microscope par les chirurgiens qui, associé à l’usage du laser, favorisent l’essor de la microchirurgie et de la chirurgie endoscopique (dès 1980 avec la cœlioscopie).
L’an 2000 marque le début de la chirurgie robotique.
Les examens paracliniques, d’inexistants au XIXe siècle, deviennent indispensables à la pratique médicale.
La découverte par W.C. Röntgen des rayons X se traduit par l’utilisation de la radiographie. Antoine Béclère réalise la première radioscopie des poumons afin de dépister une tuberculose. L’ingestion de sels de baryum à des oies par deux médecins ouvre la voie à la pratique de radiographies de contraste dès 1910, avec les premières urographies intraveineuses, puis à l’utilisation du lipiodol en 1921. Celui-ci permet d’opacifier la cavité utérine, les bronches, le canal rachidien, la vésicule biliaire. Les premières artériographies commencent en 1927. L’utilisation des isotopes radioactifs pour l’exploration ou le traitement de certains organes s’amplifie (F. Soddy, 1914 ; Frédéric Joliot et Irène Curie, 1931).
D’autres procédés apparaissent : l’étude des réactions provoquées par l’excitation électrique des nerfs et des muscles (L. Lapicque, 1909) ; l’enregistrement galvanométrique (W. Einthoven, 1903) ou électronique (H. S. Gasser, 1922) des courants produits par certains organes en fonctionnement, comme dans l’électrocardiographie (Waller, 1887 ; Lewis, 1912) ou dans l’électroencéphalographie (Hans Berger, 1931) ; l’utilisation des radiations ionisantes comme moyens thérapeutiques (travaux de Pierre et Marie Curie).
La découverte du principe de la détection des sous-marins avec les ultrasons au cours de la Première Guerre mondiale est appliquée quelques années plus tard pour la réalisation d’échographies diagnostiques (1958).
D’autres explorations non invasives apparaissent, comme la scintigraphie à partir de 1950, le scanner à partir de 1972 et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) à partir de 1976.
Dans le domaine de la santé publique, Alfred Fournier, devant l’absence de traitement efficace de la syphilis, développe une politique de prévention en insistant sur le côté dégradant des maladies vénériennes. Il préconise la chasteté prénuptiale, la fidélité, le mariage précoce et la condamnation des relations sexuelles extraconjugales. Les campagnes de prévention qu’il met en place grâce à la Société française de prophylaxie sanitaire et morale sont terrifiantes. Il démontre le concept d’hérédosyphilis, la maladie d’un père due à ses relations avec des prostituées qui a pour conséquence une atteinte de sa descendance.
Les fléaux que sont la tuberculose et l’alcoolisme aboutissent à la création de dispensaires pour le dépistage et la prise en charge de la tuberculose, et à la mise en place des campagnes de lutte contre l’alcoolisme (dès 1920).
Une épidémie de grippe commence chez des militaires au Kansas en mars 1918. Elle se diffuse en Europe, et des médecins espagnols publient les premiers travaux sur ses caractéristiques. Les premières mesures d’isolement commencent dans les hôpitaux ; malheureusement, le port de masque n’est pas généralisé. La grippe dite « espagnole » entraîne dans le monde entier environ 20 millions de morts en un an et demi (soit 2,5 fois plus que tous les morts des quatre années de guerre).
En 1981, des médecins d’Atlanta rapportent des cas de pneumonie chez de jeunes homosexuels (Pneumocystis carinii). La maladie s’étend aux États-Unis, au Danemark, en Suisse, en Angleterre et à Paris dans la communauté homosexuelle, avec un taux de létalité de 40 %. Elle est appelée sida ou syndrome de l’immunodéficience acquise. De façon quasi simultanée, le virus est identifié par Luc Montagnier en France et par Robert Gallo aux États-Unis. Après de nombreuses querelles, il est baptisé en 1986 : virus de l’immunodéficience humaine (VIH ; HIV en anglais). Le sérodiagnostic élaboré par l’Institut Pasteur en 1983 est utilisé de façon obligatoire sur les échantillons de don du sang dès août 1985.
En 1986, un deuxième virus est isolé chez les malades originaires de l’Afrique de l’Ouest.
La même année, on parle pour la première fois d’encéphalopathie spongiforme bovine en Angleterre. En 1996, le gouvernement britannique et les experts européens rapportent le lien probable entre cette maladie et la maladie neurodégénérative de Creutzfeldt-Jakob ; ce lien est confirmé en 1999.
La médecine humanitaire comporte l’aide d’urgence, les programmes de développement, l’aide aux prisonniers, la lutte contre l’exploitation du travail des enfants. Médecins sans frontières est fondé en 1971 par les Drs Bernard Kouchner et Xavier Emmanuelli pour apporter une aide aux populations civiles éprouvées par la guerre ou aux victimes de catastrophes naturelles sans aucune discrimination de race, de politique, de religion ou de philosophie. C’est la première organisation non gouvernementale qui s’est séparée de la Croix-Rouge internationale pour être libre de porter à la connaissance du public les horreurs dont elle a été le témoin au Biafra.
Dans le domaine de l’éthique médicale, de 1936 à 1945, l’unité 731 installée en Mandchourie est chargée de doter les troupes japonaises d’armes bactériologiques. Elle emploie des centaines de médecins issus de prestigieuses universités qui ont utilisé plus de 3 000 cobayes chinois et coréens (civils ou prisonniers de guerre). Ces actes de barbarie sont ignorés du tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient qui a jugé à Tokyo en 1948 les criminels de guerre japonais.
Les médecins allemands ont utilisé les déportés pour des expérimentations. Ils sont aussi présents sur les rampes d’arrivée des trains pour sélectionner les personnes aptes au travail et celles à orienter vers les chambres à gaz (les enfants, les vieillards, les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge). Un tribunal d’exception est créé pour juger ces criminels. Le tribunal de Nuremberg, avant de prononcer sa sentence, définit des règles d’éthique médicale appelées Code de Nuremberg.
Bien que ces règles d’éthique médicale existent, des médecins ne les ont pas respectées par la suite – séances de torture en Amérique du Sud et dans les asiles psychiatriques en URSS pour obtenir l’annihilation psychique des intellectuels.
La médecine moderne, de plus en plus préventive et même prédictive, se heurte à un risque majeur : son coût, avec un décalage considérable et croissant entre les pays riches et les pays pauvres.
 XXIe siècle
XXIe siècle
 Médecine
Médecine
Ce siècle est d’ores et déjà marqué par de premières évolutions :
– les greffes deviennent cellulaires, multiorganes ou nouvelles, telles les greffes du visage entier ;
– le diagnostic précoce s’étend ;
– la réparation des handicaps liés au développement technique favorise l’implantation de nouveaux matériels remplaçant peu à peu organes et membres ou parties de membres ;
– l’essor de l’informatique et la miniaturisation (nanotechnologie) permettent de nouveaux progrès – action de robots à partir de la pensée humaine ;
– les biothérapies représentent les acquis les plus marquants, notamment avec les thérapies géniques qui évoluent du fait des récents progrès du séquençage du génome humain ;
– le développement de la médecine prédictive est inéluctable ;
– la réflexion éthique biomédicale et les débats de société auxquels elle donne lieu se généralisent.
HISTOIRE DES INFIRMIÈRES
 Introduction
Introduction
Si l’art de soigner est associé à celui de guérir, la priorité de l’homme est de « soigner » pour permettre la continuité de la vie. Il s’agit d’assurer la survie de l’espèce par des soins quotidiens répondant aux besoins de l’homme en fonction de son stade de vie, et de transmettre ces savoirs de génération en génération pour prendre soin de la vie présente et future. Lorsque survient la maladie, d’autres soins sont nécessaires. Il s’agit alors de vaincre et de circonscrire le processus pathologique. Ce dernier fait l’objet de recherches à l’origine d’innovations et de progrès qui marquent l’histoire de la médecine et caractérisent le rapport au corps malade du personnel médical. Parallèlement, le médecin accroît son pouvoir sur la maladie et acquiert un statut social lui conférant reconnaissance sociale et pouvoir.
Il faut attendre le XIXe siècle pour que le corps médical admette qu’il est nécessaire de transmettre une partie de ses connaissances pour une meilleure efficacité des prescriptions et des gestes techniques délégués d’abord aux gardes-malades puis finalement aux infirmières, qui deviennent des auxiliaires médicales.
L’histoire des soins infirmiers s’est donc construite au fil des siècles au contact de l’histoire de la médecine et de la création des hôpitaux.
Les hôpitaux possèdent une histoire s’étendant sur plus d’un millénaire ; d’établissements d’assistance charitable, ils sont devenus les outils essentiels d’une politique de santé au bénéfice de la population dans son ensemble. Le progrès des communications, l’institution de la Sécurité sociale et l’évolution des techniques de soins médicaux ont abouti à la conception d’un réseau d’établissements hiérarchisés et coordonnés participant à la protection et à la promotion de la santé. La qualification du personnel et la qualité de l’équipement spécialisé deviennent les objectifs principaux du développement du système sanitaire.
C’est donc en lien avec l’essor de l’hôpital que les soins infirmiers sont apparus et se sont progressivement affirmés, répondant à une spécificité de plus en plus prépondérante dans le système de santé.
Dans l’Antiquité, on identifie des sanctuaires dédiés aux divinités guérisseuses où les malades viennent en foule mais ne sont pas autorisés à séjourner. Les moribonds et les parturientes en sont écartés et ne peuvent y avoir accès. Cependant, des infirmeries pour les soldats de métier et les esclaves apparaissent sous l’Empire romain, si bien que, lorsque la religion chrétienne triomphe au IVe siècle, l’opinion publique est plus ou moins préparée aux œuvres d’assistance.
Chronologiquement, l’initiative de la création d’établissements pour les voyageurs, pèlerins et malades pauvres remonte à la création des grands monastères bouddhiques en Inde et à Ceylan à partir du IIIe siècle avant J.-C. Les plantes médicinales y sont cultivées et largement distribuées au peuple.
À Byzance, le concile de Nicée, en 325 après J.-C., prescrit aux évêques de disposer dans chaque ville d’un lieu appelé xenodochium, où les voyageurs et les pauvres sont hébergés et soignés (70e canon arabique). L’organisation des hôpitaux byzantins influence certainement les pays qui ont des contacts étroits avec Constantinople : l’Occident romain d’une part et les pays arabes d’autre part.
Au cours du Moyen Âge, les fondations hospitalières dans l’Occident chrétien sont nombreuses mais modestes. Elles apparaissent parce qu’il devient indispensable d’héberger et de traiter les indigents de plus en plus nombreux. En France, comme dans tous les pays où les grandes religions se sont affirmées, les hospices prospèrent. Peu développés dans les villes, ils jalonnent les routes de pèlerinage, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome. Des milliers d’hôpitaux sont fondés et les représentants religieux imposent leur construction à proximité des églises ou des cathédrales (Hospices de Beaune, d’Angers, de Lübeck, etc.). Pour s’occuper des indigents et des malades, notamment des lépreux, on met à contribution des prostituées et des femmes qui doivent faire preuve de charité et d’amour de Dieu. Les soins sont bénévoles. Les religieuses restent longtemps dans les hôpitaux ou hospices, et il faut attendre la laïcisation et la Première Guerre mondiale pour que s’affirme la profession d’infirmière.
 Apparition des soins infirmiers
Apparition des soins infirmiers
 XVIIe et XVIIIe siècles
XVIIe et XVIIIe siècles
Le XVIIe siècle est largement dominé par la puissance de l’Église et sa suprématie lui confère une opulence qui creuse l’écart avec la pauvreté croissante des populations. Les indigents sont méprisés et comme ils représentent un danger social, ils sont recueillis dans les hospices qui n’ont alors pas de mission de soins et qui sont sous influence religieuse.
À partir de 1756, ces établissements subissent le courant de laïcisation et de nombreux conflits éclatent entre les religieuses, les médecins et l’administration. C’est à la fin du XVIIIe siècle que l’hôpital devient un établissement public.
Tableau 1.II
Les grandes dates pour la profession infirmière au XVIIIe siècle
| Date | Événements |
| 1789 | Nationalisation des biens de l’Église |
| 1790 | Suppression des ordres religieux mais maintien des ordres hospitaliers, les religieuses sont des fonctionnaires de l’État rétribuées |
| 1792 | Suppression des ordres religieux hospitaliers |
| 1793 | Les hôpitaux sont à la charge des départements, avec une remise en question de cette structure au profit du secours à domicile gratuit assuré par des officiers de santé (entraînant la vente des établissements) Jusqu’en 1794, les religieuses sont expulsées, exécutées ou déportées |
| 1794 | Chute de Robespierre, fin de la Terreur aboutissant à une amnistie qui suspend le démantèlement des établissements hospitaliers |
| 1796 | L’hôpital devient un établissement public avec un statut municipal. Le maire est chargé de surveiller le budget et la gestion est confiée à un receveur. Un conseil d’administration est créé, il est présidé par le maire de la ville. Le coût de l’hospitalisation est défini par un prix de journée |
 XIXe siècle
XIXe siècle
Les religieuses, malgré leur dévouement et leurs talents, sont progressivement en difficulté face à l’évolution de la médecine, ce qui entraîne la création de congrégations religieuses. Celles-ci ont pour mission d’assurer les soins, et de proposer une ébauche de formation. Il en est ainsi de la congrégation des sœurs du Bon Secours qui assurent les soins à domicile créée en 1824, de la communauté des Diaconesses de Reuilly en 1830, et de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres qui dispensent les soins aux vieillards et aux infirmes créée en 1839.
L’évolution technologique et notamment les découvertes pasteuriennes, l’asepsie et l’antisepsie, annoncent des bouleversements majeurs dans la pratique médicale. Il devient alors nécessaire d’avoir du personnel compétent pour assister les médecins dans leur activité.
Les premières infirmières laïques sont contraintes au célibat et à l’internat compte tenu du nombre considérable d’heures de travail. Leurs vêtements ressemblent à ceux des religieuses et elles assurent autant de tâches domestiques que de tâches techniques. Leur formation de type manuel est méprisée par les médecins.
Que l’infirmière soit laïque ou religieuse, sa formation devient indispensable. De ce fait, de nombreux centres de formation voient le jour, même si ces derniers fonctionnent selon des conceptions et des modalités différentes. Les enseignements sont rudimentaires et les infirmières insuffisamment formées expliquent que les progrès médicaux sont insuffisamment exploités. La première école d’infirmières municipale apparaît en 1878, à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Elle est créée sous l’impulsion du Dr Bourneville qui préconise des stages et une intensification des apprentissages. Quant à la Croix-Rouge, elle inaugure les premiers cours aux infirmières en 1899.
À l’étranger, Florence Nightingale crée l’école de l’hôpital St Thomas et instaure une hiérarchie des fonctions infirmières en 1860.
Le Conseil international infirmier (CII) est constitué en 1899 en vue de mettre en commun les intérêts professionnels et de collaborer au développement des soins infirmiers.
 XXe siècle
XXe siècle
Au début du siècle, la pratique infirmière n’a pas de contenu professionnel qui lui soit propre. Elle prend en charge tous les soins du corps sans pour autant réussir à en faire reconnaître le rôle fondamental. Elle apporte une plus-value à la pratique des médecins et se construit en référence à la prescription médicale. L’infirmière trouve alors une valorisation dans la technicité.
En 1938, la séparation entre les infirmières visiteuses (assistantes sociales) et hospitalières confirme son rôle d’auxiliaire médicale, la dépossédant ainsi de toute activité sociale. La pratique infirmière a alors pour objet principal le traitement de la maladie.
Son travail est peu reconnu socialement et économiquement. L’infirmière est le plus souvent logée, nourrie, vêtue. Elle reste en marge des lois sociales qui régissent le travail (durée, travail de nuit, salaire, repos).
Tableau 1.III
Dates et événements marquant la profession infirmière dans la première partie du XXe siècle
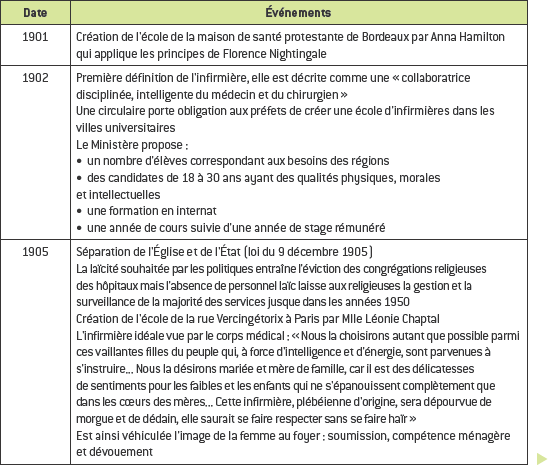
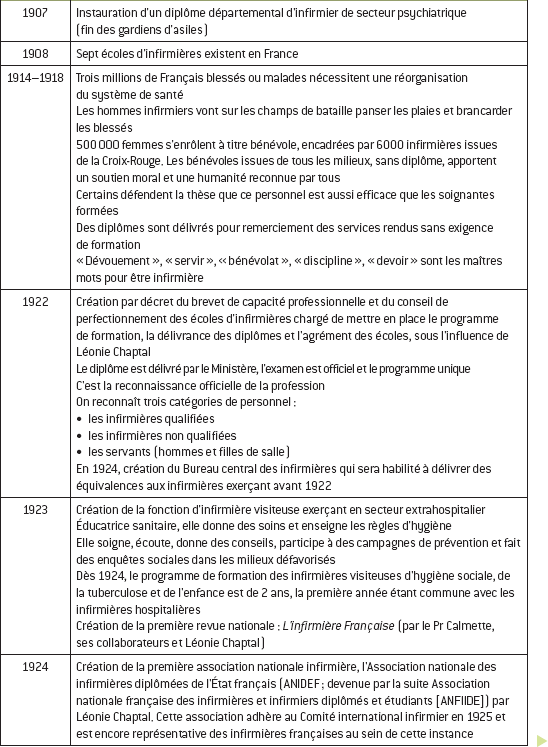
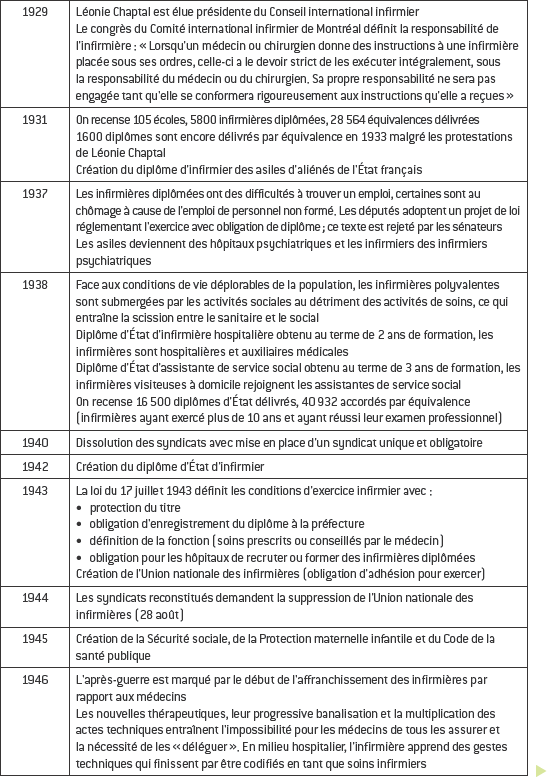
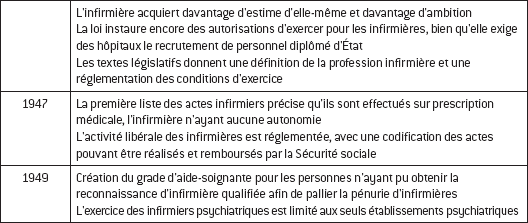
Jusqu’à la fin des années 1950, le rôle technique prédominant découle de la considération de la maladie comme enjeu essentiel de la médecine et des soins. Le corps est objet de recherche et de soins hautement techniques pour circonscrire la maladie.
Tableau 1.IV
Dates et événements marquant la profession infirmière dans les années 1950
| Date | Événements |
| 1950 | L’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose que les soins aux malades deviennent des soins infirmiers |
| 1951 | Un nouveau programme des études en 2 ans comporte une première année commune avec les assistantes sociales et les sages-femmes. Ce programme insiste sur les symptômes, syndromes et signes d’alarme qui imposent le recours au médecin La Croix-Rouge instaure une formation de cadre infirmier Création du Conseil supérieur des infirmières (organisation paritaire) qui donne un avis sur les questions relatives à l’exercice infirmier Publication par la Croix-Rouge française de la revue nationale La Revue de l’Infirmière et de l’Assistante Sociale |
| 1953 | Le Comité international infirmier adopte un code précisant les principes déontologiques des infirmières |
| 1955 | Premier diplôme national des infirmiers psychiatriques |
| 1956 | Instauration du certificat d’aptitude à la fonction d’aide-soignante Publication de la revue nationale Soins |
| 1957 | Au niveau du Ministère, le Conseil de perfectionnement des écoles devient Conseil de perfectionnement des études, qui émet un avis sur les questions de l’enseignement et de l’organisation de l’appareil de formation |
| 1958 | Premier programme de formation national en 2 ans pour les infirmières de psychiatrie La fonction d’encadrement et de formation est reconnue, entraînant la création du certificat d’aptitude à la fonction d’infirmière monitrice ou surveillante attribué au terme d’une formation de 8 mois Six écoles existent en France |
À la fin des années 1960, l’intérêt croissant pour la psychologie, les apports de la psychanalyse et des sciences humaines contribuent à changer la conception thérapeutique et à élargir le champ des soins infirmiers.
C’est avec la publication du cinquième Rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les soins infirmiers en 1966 qu’un véritable questionnement sur les besoins du malade apparaît. Ce rapport définit l’infirmière et les soins infirmiers : « l’infirmière est la personne qui, ayant suivi un enseignement de base, est apte et habilitée à assumer dans son pays la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie et les soins aux malades » – définition reprise du Conseil international infirmier.
« Au sens large, les soins infirmiers sont la fonction essentielle et originale de l’infirmière [...] assister l’individu, malade ou bien portant, dans l’accomplissement des actes qui contribuent au maintien ou à la restauration de la santé (ou une mort paisible) et qu’il accomplirait par lui-même s’il avait assez de force, de volonté et de savoir. » Cette définition reprend les termes de la définition de Virginia Henderson. Cela suppose donc que l’infirmière connaisse le malade et qu’elle entre en relation avec lui.
Les travaux d’Abraham Maslow sur les besoins de l’individu et l’analyse du développement de la personne par Carl Rogers ouvrent la voie à la recherche des éléments constitutifs de la personnalité. Ils sont à l’origine d’un courant de revalorisation de la relation soignant-soigné dans la profession infirmière, valorisation qui donne naissance au « plan de soins » et remet en cause les soins trop orientés vers la technique. En redonnant une place prépondérante à la relation soignant-soigné, la profession ouvre les portes de la recherche clinique en soins infirmiers (1980). En effet, cette relation nécessite de s’interroger sur les situations de soins, de les comprendre, de vérifier les informations recueillies et les interprétations déduites afin de prodiguer les soins dans toutes leurs dimensions.
Cette approche redonne un sens humain à la pratique des soins infirmiers, plaçant le patient au cœur des soins, le rendant actif, c’est-à-dire participant aux décisions qui concernent sa santé. La relation soignant-soigné vise à connaître et reconnaître le patient, ce qui implique que l’infirmière établisse des liens entre les informations recueillies et communiquées par la personne, tente de comprendre les incidences de la maladie sur la personne, identifie ses réactions, entre en concertation avec la personne et/ou son entourage quant aux décisions et aux soins infirmiers à proposer.
Les soins infirmiers se détachent peu à peu de l’aspect purement technique des soins pour se centrer davantage sur le patient en tant qu’individu. Cette orientation sur la nécessaire prise en compte de la personne dans son intégralité permet de mieux répondre à l’ensemble de ses besoins de santé – qu’il s’agisse des besoins physiques, émotionnels ou sociaux – et de considérer l’aspect psychosomatique de la maladie. Les soins infirmiers s’appuient dorénavant sur la mise en relation de quatre notions fondamentales : la personne, son environnement, la santé et les soins.
La pénurie frappe de plein fouet la profession, des postes restent vacants dans les hôpitaux publics et privés, des besoins sont non satisfaits en secteur libéral et un déficit d’étudiants apparaît dans les centres de formation.
Tableau 1.VII
Dates et événements marquant la profession infirmière au début du XXIe siècle
| Date | Événements |
| 2001 | Création de deux grades : cadre de santé et cadre de santé supérieur au sein de la fonction publique hospitalière avec disparition de l’appellation « surveillant » |
| 2002 | Nouvelle liste des actes infirmiers Le diplôme d’État d’infirmier donne accès à la licence de sciences sanitaires et sociales et à la licence de science de l’éducation, ce qui établit un lien avec l’université Création de la fonction de directeur des soins infirmiers de rééducation et de réadaptation, chargé d’animer l’équipe constituée de tous les paramédicaux et de coordonner leur action. Cette fonction est assurée par un cadre de santé ayant suivi une formation spécifique. Ce cadre devient directeur membre de l’équipe de direction hospitalière |
| 2004 | Le décret du 29 juillet regroupant tous les textes concernant l’exercice infirmier, les études, les spécialisations est intégré dans le Code de la santé publique |
| 2009 | Création de l’ordre infirmier Un référentiel de formation en 34 mois, centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, instaure une formation en partenariat avec l’université. L’anglais fait partie des unités d’enseignement obligatoires. La formation est intégrée dans le système licence, master, doctorat (LMD) européen |
S’ENTRAÎNER
VÉRIFIER SES CONNAISSANCES
QROC (QUESTIONS À RÉPONSES OUVERTES COURTES)
1. Énoncez en quelques lignes l’évolution des caractéristiques des soins selon qu’ils sont dispensés par les hommes ou par les femmes au fil de l’histoire.
2. Énoncez l’élément fondamental qui a permis le développement des savoirs et précisez son influence sur l’évolution de la médecine.
3. Expliquez pourquoi et en quoi l’arrivée du christianisme modifie les pratiques soignantes.
4. Expliquez brièvement les raisons qui ont conduit à « l’apparition de l’infirmière ».
5. Citez et précisez les humeurs qui prévalent dans la médecine grecque antique.
L’exercice de la médecine grecque est régi par le .......................... dont les médecins actuels ont hérité. Ce serment est composé de deux types de consignes : ...................................................................................... Les deux conceptions mises en évidence étant de proscrire tout risque ........................................................ et .......................... Ainsi, la notion du ........................................................ apparaît comme absolue, le sort du malade est reconnu comme prioritaire.
Les micro-organismes responsables des maladies infectieuses sont isolés à partir des travaux de ........................... et de ............................. La coloration de ........................... (1884) est mise au point ; il s’agit d’une technique de coloration qui permet de différencier les .........................
Les lois sur l’hérédité sont exprimées par........................... dans un travail de statistiques resté confidentiel (1865).
Au début du siècle, les chirurgiens sont très adroits et de grande valeur, mais ils opèrent peu car ils doivent faire face à de nombreux échecs. Les trois ennemis historiques de la chirurgie sont : ............................, ........................... et ............................
À la fin du siècle, la chirurgie est en plein essor grâce à :
– l’abolition de la douleur par l’apparition de l’............................. Celle-ci est pratiquée avec de .......................... à partir de 1846, puis avec du ....................... en 1847 (permettant des interventions d’une durée inférieure à 60 minutes) ;
– la prévention de l’infection grâce aux travaux de .......................... qui met en évidence l’intérêt du phénol en 1867 (l’antisepsie) et aux méthodes d’asepsie (1886) par chaleur sèche (étuve ou flambage) ou humide (autoclave), l’usage de gants de caoutchouc stérilisés, et le port de blouses, de calots à partir de la fin du siècle ;
– l’évolution des instruments chirurgicaux comme la mise au point de pinces hémostatiques par .......................... et.............................., les écarteurs de ..............................
L’œuvre scientifique de Louis Pasteur porte sur :
– l’étude et le rôle des ........................... qu’il identifie en 1878 ; il met fin à la théorie de ........................... ;
– l’................................. et l’.................................. (lavage des mains, flambages des instruments, passage au four des matériaux de pansements, usage d’eau bouillie) ;
– la ........................... (le vieillissement de culture microbienne entraîne l’atténuation de sa virulence).
La découverte des groupes sanguins du système ABO en 1901 par ........................... favorise les transfusions sanguines bras à bras. En 1940, on découvre le facteur ............................
Ogino crée une méthode de contraception fondée sur la surveillance de ........................... en 1930.
Le BCG, en 1921, est mis au point par.......................... et ........................... Ce vaccin devient obligatoire en France en 1950 pour les enfants dès l’âge de 6 ans, pour lutter contre .........................
9. Complétez le tableau de la page suivante en précisant la date correspondant aux événements cités dans la colonne de gauche.
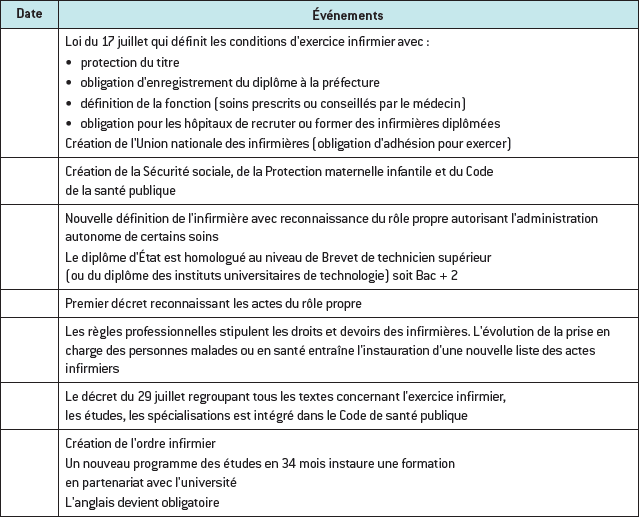
QCM
1. Les Grecs sont considérés comme les pères fondateurs de la médecine moderne car ils ont :
A Développé une approche scientifique de la médecine
B Donné des règles déontologiques à sa pratique
C Associé des connaissances magiques et scientifiques
2. Au Moyen Âge, les qualités de la religieuse travaillant dans les Hôtels-Dieu sont :
3. Au XVIIe siècle, la théorie de Galien identifiant la maladie comme un déséquilibre des humeurs est remise en cause par la découverte de William Harvey. Cette découverte est :
B La circulation sanguine et le rôle moteur du cœur
C L’anatomie de l’appareil génital féminin
4. Ambroise Paré, chirurgien de la Renaissance, innove dans sa pratique en :
A Remplaçant la cautérisation des plaies par la ligature artérielle
B Développant l’art du pansement
C Utilisant des procédures d’hygiène pendant ses interventions
5. Au XVIIIe siècle, la Révolution impose pour les religieuses soignant les malades dans les hôpitaux :
6. L’examen du corps humain est complété au XIXe siècle par l’usage de :
7. Après la Révolution française, les hôpitaux sont gérés par :
8. Les premières formations pour des infirmières laïques se mettent en place en :
9. Au cours de la Première Guerre mondiale se développe :
A La mise en place de postes de secours pour une prise en charge précoce
B La pratique de l’injection antitétanique pour tous les blessés
10. Le premier certificat national validant la capacité d’être infirmière date de :
11. L’Association nationale des infirmières diplômées de l’État français (ANIDEF) est créée en 1924 par :
12. Le programme de formation des infirmières de 1951 est fondé sur l’apprentissage :
B Des besoins fondamentaux de la personne malade
13. Une loi définit la fonction infirmière et pour la première fois reconnaît un rôle propre en :
14. Marie-Françoise Collière est une infirmière qui s’est attachée à faire reconnaître :
B L’identité des soins infirmiers au cours de l’histoire
C La reconnaissance européenne du diplôme d’État français
D La reconnaissance de l’équivalence de la licence
E La libre circulation des infirmières au sein de la Communauté européenne
15. La réforme du programme des études de 1992 instaure :
A Un diplôme d’infirmier de soins infirmiers généraux
B Une reconnaissance européenne du diplôme de soins infirmiers généraux
C Le statut d’étudiant pour les infirmières en formation
16. Claude Bernard est le père de :
A La première école d’infirmières
B La première école de sages-femmes
18. Luc Montagnier identifie :
19. Jean Esquirol décrit les maladies :
20. Jenner met au point la technique de :
A Mis en évidence que la mort peut être liée à des désordres chimiques
C Développé la pratique de la réanimation
D Réalisé la première greffe rénale
E Développé la prise en charge extrahospitalière des aliénés
24. Alexandre Yersin a découvert :
A Le bacille responsable de la tuberculose
B Le bacille responsable de la peste
C Le bacille responsable du choléra
26. Alexander Fleming a découvert :
CORRIGÉS
VÉRIFIER SES CONNAISSANCES
QROC (QUESTIONS À RÉPONSES OUVERTES COURTES)
1. Les hommes assurent préférentiellement les soins qui nécessitent de la force parce qu’ils sont plus forts et plus grands, alors que les femmes assurent les soins quotidiens qui permettent la survie de l’espèce (alimentation, hygiène). Elles s’occupent des soins aux enfants, aux malades et aux mourants, auprès desquels elles assurent les soins du corps et les pratiques alimentaires. De cette pratique découlera l’évolution des soins ; ainsi, les soins curatifs seront réservés aux hommes alors que les soins d’entretien seront réservés aux femmes.
2. L’écriture est le point de départ de la formalisation des savoirs acquis de l’expérience, du questionnement et du doute. Les personnes cultivées sachant lire et écrire, telles que les prêtres, consignent les connaissances apportées par les hommes et assurent leur transmission à des personnes relevant de certaines catégories sociales. C’est ainsi qu’elles imposent leur suprématie et permettent l’apparition du médecin qui s’approprie les savoirs « scientifiques ».
Les savoirs empiriques de la vie quotidienne, nécessaires pour perpétuer la vie, deviennent l’apanage des femmes. Ainsi, « soigner » prend deux orientations distinctes : assurer la continuité de la vie (réservé aux femmes) et restaurer la santé (réservé aux hommes).
3. L’arrivée du christianisme modifie les pratiques soignantes parce que les connaissances en lien avec les mystères de la nature sont suspectes, que le corps est considéré comme impur et, de ce fait, les soins du corps sont méprisés car considérés comme charnels. L’esprit l’emporte sur le corps et les soins deviennent spirituels. Le corps doit connaître la souffrance physique pour se racheter et seule une personne ayant renoncé à elle-même peut donner ces soins.
Les pratiques soignantes passent sous le contrôle de l’Église, les religieux sont les détenteurs des pratiques permettant de soigner l’âme, les pratiques de soins du corps (hygiène, massage, etc.) sont délaissées.
4. La séparation de l’Église et de l’État fait que les religieuses sont de moins en moins présentes dans les établissements de soins et laissent la place à un personnel laïc. Par ailleurs, l’évolution de la médecine, liée aux découvertes en sciences physiques et chimiques, modifie les pratiques soignantes et l’activité médicale qui est davantage centrée sur la pose des diagnostics et sur le traitement des maladies. Ainsi, le médecin utilise de plus en plus de techniques élaborées et il lui est nécessaire d’être secondé.
5. Les humeurs qui prévalent dans la médecine grecque antique sont : le sang, la bile, l’atrabile, le phlegme.
6. L’exercice de la médecine grecque est régi par le serment d’Hippocrate dont les médecins actuels ont hérité. Ce serment est composé de deux types de consignes : les assertions et les interdits. Les deux conceptions mises en évidence étant de proscrire tout risque de nuire et de taire ce qui ne doit pas être divulgué. Ainsi, la notion du secret médical apparaît comme absolue, le sort du malade est reconnu comme prioritaire.
7. Les quatre principes de cette éthique sont : l’intérêt du malade, plus important que celui du médecin ; le refus d’accomplir des actes dangereux ; le secret professionnel, le respect de l’intimité ; l’obligation de formation.
8. Les micro-organismes responsables des maladies infectieuses sont isolés à partir des travaux de Joseph Pasteur et de Robert Koch. La coloration de Gram (1884) est mise au point ; il s’agit d’une technique de coloration qui permet de différencier les bactéries.
Les lois sur l’hérédité sont exprimées par Gregor Mendel dans un travail de statistiques resté confidentiel (1865).
Au début du siècle, les chirurgiens sont très adroits et de grande valeur, mais ils opèrent peu car ils doivent faire face à de nombreux échecs. Les trois ennemis historiques de la chirurgie sont : l’hémorragie, la douleur et l’infection.
À la fin du siècle, la chirurgie est en plein essor grâce à : l’abolition de la douleur par l’apparition de l’anesthésie. Celle-ci est pratiquée avec de l’éther à partir de 1846, puis avec du chloroforme en 1847 (permettant des interventions d’une durée inférieure à 60 minutes) ; la prévention de l’infection grâce aux travaux de Joseph-Claude Lister qui met en évidence l’intérêt du phénol en 1867 (l’antisepsie) et aux méthodes d’asepsie (1886) par chaleur sèche (étuve ou flambage) ou humide (autoclave), l’usage de gants de caoutchouc stérilisés, et le port de blouses, de calots à partir de la fin du siècle ; l’évolution des instruments chirurgicaux comme la mise au point de pinces hémostatiques par Jules-Émile Péan et Emil Theodor Kocher, les écarteurs de Louis Farabœuf.
L’œuvre scientifique de Louis Pasteur porte sur : l’étude et le rôle des germes qu’il identifie en 1878 ; il met fin à la théorie de l’hétérogénie ; l’asepsie et l’antisepsie (lavage des mains, flambages des instruments, passage au four des matériaux de pansements, usage d’eau bouillie) ; la vaccination (le vieillissement de culture microbienne entraîne l’atténuation de sa virulence). La découverte des groupes sanguins du système ABO en 1901 par Karl Landsteiner favorise les transfusions sanguines bras à bras. En 1940, on découvre le facteur Rhésus.
Ogino crée une méthode de contraception fondée sur la surveillance de la température corporelle en 1930.
Le BCG, en 1921, est mis au point par Léon-Charles-Albert Calmette et Jean-Marie Guérin. Ce vaccin devient obligatoire en France en 1950 pour les enfants dès l’âge de 6 ans, pour lutter contre la tuberculose.
1Marie-Françoise Collière, Soigner.. Le premier art de la vie, Paris, Masson, 1996.
2Marie-Françoise Collière, Promouvoir la vie. De la pratique des femmes soignantes aux soins infirmiers, Paris, Masson, 1998.
3Barbara Ehrenreich, Deirdre English, Sorcières, sages-femmes et infirmières, Québec, Éditions du Remue-Ménage, 1983.
4Lire partout infirmier(ère).
5À partir d’Encyclopædia Universalis, article de Charles Coury.
6Classiquement, l’époque contemporaine débute en France en 1789, à la Révolution.
7En 1949, au congrès de rhumatologie de New York, Philip Hench présente le premier jour une malade impotente en raison de ses rhumatismes ; le quatrième jour, les congressistes sont stupéfaits car la malade était libre de ses mouvements : elle avait reçu cette nouvelle molécule.
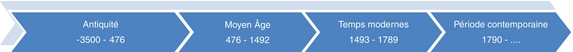

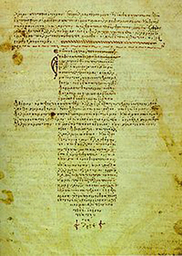
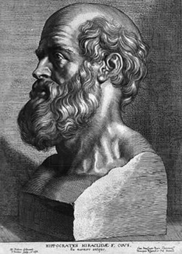
 της.
της.